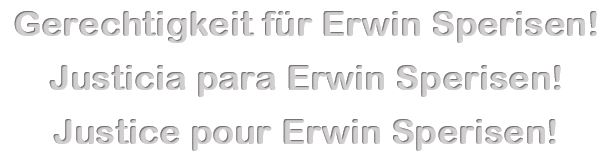Le Dossier Sperisen
Les protocoles d’un crime judicaire
Lorsqu’en août 2012, le procureur genevois Yves Bertossa envoie un commando de police armé jusqu’aux dents pour arrêter Erwin Sperisen, il est convaincu de mettre en prison un grand criminel. Très vite, Bertossa doit impérativement avoir compris que l’investigation contre le chef politique de la police du Guatemala était truffée de dissonances et exempte de toute crédibilité. Mais plus la détention préventive durait, plus Bertossa s’obstinait à ne pas perdre le Nord. Avec la complicité de quelques juges genevois, comme lui adeptes des « gros » cas prestigieux, il s’accrochait avec acharnement à cette affaire. Plus les contradictions devenaient grotesques, moins le procureur pouvait admettre s’être laissé prendre au piège d’une intrigue politique et avoir emprisonné la mauvaise personne.
Parce qu'il ne peut y avoir ce qui ne peut être, Genève, au nom des Droits de l’homme, a jeté par-dessus bord toutes les règles d'un procès équitable. Le journaliste zurichois Alex Baur suit l’affaire Sperisen depuis ses débuts. La totalité des « Protocoles d’un crime judicaire » étaient publiés originalement en allemand dans die Weltwoche, entre 2015 et 2010. Ci-après une traduction sélective de certains de ses articles.
Sommaire
3. Une expérience épouvantable
4. «Un cauchemar interminable»
6. République fromagère hors-jeu
8. Révision du procès Sperisen
1. La confusion de Genève
22.10.2015 - A cause d'un massacre dans une prison au Guatemala, la justice genevoise veut envoyer Erwin Sperisen à perpétuité derrière les barreaux. Le descendant d'émigrants suisses est-il vraiment l'auteur de plusieurs meurtres – ou la victime d'un crime judiciaire?
A l'aube du 25 septembre 2006, les forces d'intervention – 2500 policiers, soldats, forces spéciales, gardiens – donnent l'assaut à la prison El Pavón, à Guatemala City. Tandis que la plupart des quelque 1800 détenus se rendent immédiatement, une violente fusillade éclate dans la partie est de l'immense terrain. La situation s'apaise un peu après 8 heures et, à 11 heures, les autorités dressent le bilan devant la presse rassemblée : la prison est sous contrôle, sept détenus sont morts, un détenu est blessé.
Dans les médias guatémaltèques, le raid effectué sous le commandement du ministre de l'Intérieur, Carlos Vielmann, sera unanimement salué comme un succès. El Pavón, planifiée et construite comme une prison modèle avec des terrains de sport, des ateliers et une exploitation agricole, était depuis longtemps considérée comme un terreau du crime organisé. Depuis des années, les gardiens ne se hasardaient guère dans son enceinte. El Pavón était contrôlée par des gangs qui y organisaient en toute impunité leurs hold-up, trafics de drogue, assassinats et enlèvements. La plupart des Guatémaltèques, probablement, estimaient acceptable ce tribut de sang qui, dans le contexte latino-américain, ne leur semblait sans doute pas trop excessif.
Six années plus tard, le 31 août 2012, un groupe d'intervention de sept personnes, lourdement armées surprend Erwin Sperisen à Genève, sur le parking d'un centre commercial, et l'emmène, menotté, sous les yeux de son épouse ahurie. Depuis ce jour, Erwin Sperisen, aujourd'hui âgé de 44 ans, est en détention provisoire à la prison genevoise de Champ-Dollon. Il est accusé, en tant que chef politique des forces de police guatémaltèques, Policía Nacional Civil (PNC), d'avoir, lors de la prise d'assaut d'El Pavón, ordonné l'exécution de sept détenus et même d'en avoir exécuté un lui-même.
Témoignage accablant
Sperisen, descendant d'immigrants suisses, est né au Guatemala et a toujours gardé sa citoyenneté suisse. Par conséquent, il ne peut pas être extradé. Cela n'a d'ailleurs pas été nécessaire, car le procureur Yves Bertossa (PS) était désireux de faire le procès de cet homme à Genève. Depuis des années, des soupçons circulaient dans les milieux de gauche à l'encontre de Sperisen, qui, selon eux, jouait les Monsieur Propre d'extrême-droite au Guatemala, où il sévissait avant de fuir dans la patrie de ses ancêtres. Bertossa était enfin convaincu d'avoir quelque chose de concret en main contre lui.
Dès le lendemain de l'arrestation, le Français Philippe Biret faisait une déposition accablante devant Bertossa: Biret disait avoir vu de ses propres yeux Erwin Sperisen, entouré de l'élite du gouvernement guatémaltèque, superviser l'exécution des sept détenus. Ces derniers se seraient rendus depuis longtemps et imploraient grâce. Le géant suisse aurait, selon Biret, abattu lui-même l'une des victimes d'un tir à la tête. Le Français assurait même que Sperisen l'aurait laissé en vie par crainte de complications diplomatiques.
Bertossa a obtenu Biret par le biais de l'organisation TRIAL, une ONG de la gauche tiersmondiste genevoise qui se consacre à la poursuite des crimes politiques impunis dans le monde entier.
Biret a été condamné en 1992 au Guatemala à trente ans de prison pour double meurtre et était détenu à ce moment-là dans la prison El Pavón. Bien que le jugement du tribunal guatémaltèque ait explicitement exclu toute libération anticipée, il a été libéré en novembre 2007. Cette libération était pour le moins surprenante. Mais Bertossa n'a pas posé de questions gênantes. Il avait urgemment besoin du Français comme témoin clé. Bertossa s'en tiendra toujours aux déclarations de Biret, même quand il deviendra évident que son histoire à faire frémir ne tient pas la route. A ce stade, on ne peut plus stopper la procédure. Avec l'arrestation spectaculaire de Sperisen le procureur s’est placé lui-même dans l'obligation de réussir.
A première vue, des éléments accusent Erwin Sperisen, chef de la police nationale du Guatemala entre 2004 et 2007. Dès décembre 2006, le procureur spécial guatémaltèque pour les Droits de l'homme avait émis des doutes quant à la version officielle selon laquelle les sept détenus seraient tombés pendant les combats. Les forces de l'ordre n'ont pas enregistré un seul blessé, tandis que les prisonniers sont tous morts sur le coup. Ceci est d'autant plus étonnant que le Ministère public a trouvé, à côté des cadavres, des armes lourdes et des grenades à main une heure après l'échange de coups de feu.
Il y avait toujours l’odeur d’une mise en scène, mais aussi une absence frappante de preuves. Des centaines de témoins oculaires et auditifs étaient présents à El Pavón lors de la fusillade qui a été suivie par de nombreux journalistes. Le relevé des empreintes et l'autopsie des cadavres ont été bâclés, les dépositions des témoins étaient bourrées de contradictions. Mais il y avait des photos des cadavres. Et celles-ci montraient des blessures par balles qui collent mal avec un combat. Des marques aux poignets suggèrent qu’au moins deux détenus auraient été ligotés avant de mourir.
Toutefois, ces indices ne sont pas non plus clairs. Personne ne sait quand ces marques présumées ont été produites. Dans le cas de plusieurs victimes, la raison de décès invoquée est «mort entraînée par perte de sang», ce qui va à l'encontre de la thèse de l'exécution. On trouve même dans les dossiers une expertise judiciaire effectuée en Autriche ; l'expert conclut, en s'appuyant sur des enregistrements vidéo, que des coups de feu sont bel et bien partis de la prison.
Sperisen s'est-il contenté de détourner les yeux ?
Certains des morts, en premier lieu le « narco » colombien Jorge Batres et le gangster Luis Zepeda, faisaient partie des « dirigeants » d'El Pavón. Les avoir délibérément éliminés pour prendre ultérieurement le contrôle de la prison aurait un sens. Cela concorderait aussi avec le rapport de l'envoyé de l'ONU Philip Alston, qui avait déjà trouvé des indices d’exécutions extrajudiciaires avant l'affaire El Pavón. Mais Alston n'a, lui non plus, pas su répondre à la question cruciale : qui a donné les ordres ?
Aux côtés de la police, de l'armée et des services de renseignements se sont mêlés pendant ce raid monstre à El Pavón des troupes d'élite masquées, formellement sous les ordres directs du ministre de l'Intérieur Carlos Vielmann. Des prises de vues que le chef de la police Sperisen avait fait filmer – n'étant manifestement pas lui-même sur place à ce moment-là – montrent que ce sont principalement les troupes d'élite de Vielmann qui sont impliquées dans la fusillade. Elles étaient commandées par Victor Rivera, Vénézuélien d'origine, un personnage haut en couleur suspecté d'avoir jadis travaillé pour la CIA. Malheureusement, Rivera ne peut plus rien dire. Il a été abattu par des tueurs à gages en 2008. Le Guatemala est un pays dangereux et compliqué.
Était-ce peut-être la tentative désespérée du gouvernement de vaincre le crime par le crime? Ou tout simplement un règlement de comptes entre cartels de la drogue dont les tentacules pénètrent profondément dans l'appareil de l’État ? Est-ce que les troupes régulières et, en particulier, le chef de la police Sperisen étaient de la partie lorsque les escadrons de la mort ont frappé? Se sont-ils contentés de détourner le regard ? Peut-être le commando spécial de Rivera a-t-il mis la fusillade en scène pour accomplir son œuvre mortifère dissimulée dans le nuage de poudre de la fusillade. Tout est possible, rien n'est certain.
Chasse à l'ex-chef de la police
La justice et la police ont une réputation catastrophique dans toute l'Amérique latine et, tout particulièrement, au Guatemala. Trente-six ans de terreur des guérilla (1960–1996) ont durablement ravagé le tissu social et politique du pays. Les puissants cartels de la drogue du Mexique et de la Colombie font tout pour que le pays ne s'apaise pas. Vols, assassinats et enlèvements font partie du quotidien des Guatémaltèques. La probabilité qu'un crime soit élucidé est minime. Et, si quelqu'un atterrit en prison, cela ne veut pas dire nécessairement qu'il soit coupable. La justice dans ce pays a trop souvent été un prolongement de la politique par d'autres moyens. Des policiers corrompus qui coopèrent, plus ou moins au vu et au su de tous, avec des criminels au lieu de les combattre sont plutôt la règle que l'exception. Lorsque la justice faillit, c'est le droit du plus fort qui l'emporte.
Quel rôle a joué Erwin Sperisen sur ce champ de bataille ? Était-il la règle ou l’exception ? Contrôlait-il vraiment sa police en tant que chef politique sans expérience policière ? Était-il au cœur de complicités criminelles ou, comme lui-même l'affirme, leur victime ? La justice guatémaltèque n'a jamais été en mesure de fournir une réponse convaincante. Mais le procureur Bertossa a cru pouvoir résoudre l'affaire de son lointain bureau genevois. Pour lui, tout a semblé clair, au plus tard après l'audition du témoin clé Biret.
Pourtant, la justice guatémaltèque n'était pas restée inactive. En décembre 2006, le gouvernement centre-droit de Oscar Berger a fait venir dans le pays une commission internationale, la CICIG, qui, sous l'égide de l'ONU, devait mettre de l'ordre dans le dossier de poursuite pénale. L'enquêtrice spéciale, la Costaricaine Gisela Rivera, est bientôt arrivée à la conclusion qu'un complot tramé au plus haut niveau se cachait derrière le massacre d'El Pavón. Gisela Rivera a quitté précipitamment le Guatemala en 2009. L'enquêtrice de la CICIG est sous le coup d'un mandat d'arrêt pour entrave à l'action pénale et violation du secret de fonction. La plainte émanait directement de la CICIG. Gisela Rivera aurait contraint des témoins à faire des dépositions et serait suspectée de collusion.
Cela n'est pas dû à l'environnement politique, le gouvernement conservateur de Berger ayant été remplacé au 2008 par ses opposants socialistes. Gisela Rivera affirme que son supérieur hiérarchique à la CICIG, l'Espagnol Carlos Castresana, était acheté par l'oligarchie. Avant le départ de Castresana, la CICIG avait tout de même engagé, en août 2010, des poursuites contre dix-huit suspects dans l'affaire El Pavón. Erwin Sperisen et son adjoint Javier Figueroa figuraient parmi les quatre principaux suspects aux côtés du ministre de l'Intérieur Carlos Vielmann et du directeur du système pénitentiaire Alejandro Giammattei. Seuls trois policiers subalternes ont finalement été condamnés.
Procédures pompeusement mises en scène
Erwin Sperisen était alors déjà depuis longtemps en Suisse, sans lien avec l'affaire El Pavón. Fin 2006, il a envoyé sa femme et ses trois enfants chez son père à Genève, où ce dernier occupe un poste de diplomate de l'ONU, à la suite de menaces de mort et d'une tentative d'enlèvement déjouée. En mars 2007, il a démissionné de ses fonctions et est venu rejoindre sa famille en Suisse. L'évènement déclencheur de son départ fut l'affaire de trois hommes politiques salvadoriens pris en flagrant délit de contrebande de cocaïne, dépouillés et assassinés par des policiers guatémaltèques. C'était un scandale qui nécessitait un geste politique.
Quelques mois après l'arrivée de Sperisen en Suisse, un réseau d'ONG de gauche (Uniterre, Acat, OMCT) sous la direction de l'organisation TRIAL a appelé à se lancer à la chasse de l'ex-chef de la police. Il n'était toutefois pas encore question d'El Pavón. Il s'agissait plutôt d'un conflit sanglant entre des paysans dans une province reculée, qui avait coûté la vie à neuf personnes (les ONG taisant ici volontiers la mort parmi elles de trois policiers, 22 autres policiers blessés par balles selon une enquête parlementaire, et ce, notons-le bien, au cours d'une opération de police ordonnée par la Cour suprême du Guatemala). A ce moment-là, Sperisen était en poste depuis un mois et le rendre responsable de ce bain de sang était absurde. Mais cela a mis une chose en évidence : depuis le début, l'affaire Sperisen est contaminée par la politique.
Après la mise en accusation par la CICIG au Guatemala en août 2010, Erwin Sperisen s'est spontanément présenté auprès de l'ancien procureur général de Genève Daniel Zappelli (PLR). Ce dernier n’a pas pu faire grand-chose de cette affaire. Le vent tourne brusquement lorsqu'un an plus tard, Zappelli doit quitter son poste, harcelé par son propre personnel. C'est juste le moment où le camarade Yves Bertossa est promu premier procureur. Bertossa, étroitement lié sur le plan idéologique, amical et familial avec l'organisation TRIAL, s'empare alors du dossier Sperisen. Il veut en faire son ouvrage de compagnonnage.
Il est bon de savoir aussi qu'Yves Bertossa est le fils du fameux Bernard Bertossa (PS), qui, en tant que procureur général de Genève (1990–2002) – en quelque sorte le Jean Ziegler de la justice – a mené une croisade internationale contre les potentats, oligarques et autres prédateurs capitalistes. En collaboration avec son homologue espagnol Baltasar Garzón, il a émis un mandat d'arrêt international contre l'ex-dictateur chilien Augusto Pinochet en 1998. Bernard Bertossa est l'un des membres fondateurs de l'organisation TRIAL, cofinancée par la ville de Genève, et qui a déjà, par le passé, exigé l'arrestation de l'ancien président des États-Unis George Bush.
Les procédures pompeusement mises en scène dans les médias par Bernard Bertossa ont régulièrement dégénéré et se sont soldées par un échec. Le prétendu parrain de la mafia russe Sergej Michailow, auquel l'État de Genève a dû verser 800 000 francs pour avoir passé deux ans en détention provisoire injustifiée, est un exemple parmi plusieurs. Son successeur Zappelli a tenté de faire revenir le Parquet genevois sur le terrain de la réalité helvétique. Manifestement en vain.
«Il a déjà un nom» se moquaient les Genevois du fils du fameux procureur général Bertossa lorsqu’en 2007 il était nommé procureur sur les brisées de son père, «il ne lui manque plus qu'un prénom». Yves Bertossa n'a pas perdu de temps. Le scandale ne s'est pas fait attendre avec l'arrestation en 2008 d'Hannibal Kadhafi, le fiston du dictateur. L'affaire Kadhafi a aussi été un coup d'épée dans l'eau avec des dommages collatéraux considérables. Erwin Sperisen était-il censé apporter la percée tant attendue ?
En mars 2014, deux mois avant le procès Sperisen, la télévision romande RTS diffuse un documentaire (« Chasseurs de crimes ») qui fait l'éloge de l'organisation TRIAL. L'affaire Sperisen est au cœur du film, remettant sur le tapis le conflit sanglant avec les paysans. Philippe Biret, témoin clé de Bertossa, s'y exprime en long et en large, y décrivant de façon dramatique la soi-disant exécution commise par Sperisen à El Pavón. Néanmoins, les auteurs mentionnent que les accusations de Biret sont controversées. Ils laissent la conclusion au copain de Bertossa, Baltasar Garzón, qui estime difficile d'apporter des preuves contre les vrais criminels, mais que le combat vaut la peine.
L'opinion publique semble être très bien préparée – jusqu'au 14 mai 2014, la veille du procès Sperisen, lorsque le magazine L’Illustré fait exploser une bombe : la soi-disant plaignante privée, la mère de l'une des victimes d'El Pavón, n'est pas au courant du procès ; elle ne connaît pas les avocats qui parlent en son nom, elle n'est pas au courant de l'accusation portée contre Sperisen et n'a rien contre l'ancien chef de la police. Arnaud Bédat, reporter expérimenté, a rendu visite à cette femme au Guatemala et a filmé en vidéo l'entretien qu'il a mené avec elle.
Ce scoop a mis dans un vif embarras l'organisation TRIAL qui récoltait des dons avec succès pour cette femme. Cela n'a pas changé grand-chose sur le plan juridique : un assassinat est un délit poursuivi d'office. Il aurait suffi à la présidente du tribunal Isabelle Cuendet (PS) de suspendre temporairement la plaignante jusqu'à la clarification de cette situation. Mais la réaction arrogante de Cuendet a été révélatrice: elle a balayé la question déclarant hargneusement qu'elle n'allait pas laisser des journalistes s'immiscer dans ses affaires.
« Affaire de justice coloniale »
Dès le début, l'ambiance dans la salle d'audience était très pesante. « Si Erwin est coupable, il doit en subir les conséquences, déclare son frère Christian Sperisen, mais tout accusé a le droit d'être pris au sérieux et entendu.» Il avait vite compris que le verdict était prononcé avant le procès. En certaines occasions, Cuendet coupait sèchement la parole à l'accusé quand il ne disait pas ce qu'elle voulait entendre de lui ; à d'autres reprises, elle l'accusait, énervée, de « jouer au chat et à la souris »; d'autres fois, elle se moquait d'un geste sarcastique d'un témoin à décharge.
L'ambiance agressive dans la salle d'audience l'a choqué, déclare rétrospectivement le reporter Arnaud Bédat, qui n'avait jamais rien vécu de tel. Et il n'est pas le seul à avoir eu cette impression. La chroniqueuse judiciaire Catherine Focas a critiqué plus tard toute la procédure dans la Tribune de Genève, la qualifiant d’« affaire de justice coloniale». Si Sperisen avait été « un notable local », a-t-elle écrit, il n'aurait pas été traité avec un tel dédain.
Si l'on s'en tient au mince acte d'accusation du procureur Bertossa, seulement quatre pages pour le point essentiel, il y a eu un complot criminel tramé au plus haut niveau. Il n'a pas tranché sur la question de savoir qui avait décidé et fait quoi, ni quand ni comment. Pour une bonne raison. Car l'accusation repose en substance sur deux piliers qui se contredisent l'un l'autre : les déclarations du témoin clé, Philippe Biret, et les enquêtes de la CICIG au Guatemala qui n'ont guère de dénominateur commun.
Il est assez facile de réfuter la version de Biret: selon tous les rapports, aucun des sept prisonniers n'a reçu de balle dans la tête et le Français qui a situé le massacre en fin d'après-midi s'est trompé de huit bonnes heures. La raison pour laquelle Bertossa s'en est pourtant tenu à son histoire abracadabrantesque est évidente : les déclarations de témoins de la CICIG sont lacunaires et contradictoires. Et les quelques dépositions qui incriminent Sperisen proviennent manifestement de programmes de clémence : les coprévenus qui ont témoigné contre leur chef ont été récompensés par une promesse de remise de peine et de programmes de protection des témoins. Or de tels deals sont illégaux en vertu du droit suisse parce que le risque de fausse accusation est trop grand.
La Cour criminelle de Genève a piqué soigneusement dans les déclarations contradictoires tout ce qui incriminait Sperisen et l'a condamné le 6 juin 2014 pour septuple meurtre à la réclusion à perpétuité. Ce qui n'allait pas dans le sens de sa culpabilité a été écarté comme insignifiant, les grossières contradictions dans la version de Biret ont été mises sur le compte d'un traumatisme qui aurait légèrement falsifié ses souvenirs. Les 142 pages de matériel juridique indigent seraient à elles seules un sujet en soi. Mais ce n'est plus la peine de s'en occuper puisqu'elles sont désormais caduques.
Dans son jugement du 12 juillet 2015, la Cour d'appel de Genève a qualifié de non crédible l'histoire à faire frémir du témoin Biret. Par prudence, l'instance d'appel a également considéré l'enquête de la CICIG que comme un simple indice. Pourtant, les juges ont prononcé un verdict de culpabilité: Erwin Sperisen était le chef, il portait donc la responsabilité des crimes qui avaient été commis sous sa tutelle. Il ne paraissait pas possible qu'il n'ait pas remarqué les exécutions.
Alors que la Cour traite la question clé de la connaissance des faits par Sperisen en quelques pages, la majeure partie des considérants du jugement tourne autour de la question de savoir s'il y a effectivement eu exécution. Seulement, Sperisen lui-même n'avait jamais exclu cette possibilité. Selon ses dires, son apparition martiale en uniforme en marge de la prise d'assaut d'El Pavón n'avait été qu'un show. L'opération était dirigée par les commandants respectifs, et en tant que chef politique de la police, il n'avait assumé qu'une pure fonction représentative.
Étant donné que Sperisen ne peut avoir ordonné seul le plan criminel, la Cour d'appel de Genève a aussi condamné son adjoint Javier Figueroa et le directeur du système pénitentiaire Alejandro Giammattei. Or il se trouve que le même Giammattei a déjà été acquitté en 2011 au Guatemala dans la même affaire. Figueroa, qui vit officiellement aujourd'hui comme réfugié politique en Autriche, a été disculpé en 2013 par un jury après un long procès. Le ministre de l'Intérieur Carlos Vielmann coule actuellement des jours paisibles de retraité en Espagne. Erwin Sperisen ne peut aujourd'hui placer ses espoirs que dans le Tribunal fédéral de Lausanne, où son affaire est en attente de jugement.
Jean Ziegler s'en mêle
Pourquoi les juges genevois se sentent-ils si sûrs dans cet imbroglio qui s'est déroulé si loin de leur réalité? Cela tient probablement aussi à une photographie qui montre un rouquin de presque deux mètres, armé jusqu'aux dents, au cours du raid à El Pavón. Cette photo qui accompagne tous les articles sur Erwin Sperisen fait penser à une caricature d'un brutal mercenaire gringo qui piétine des cadavres dans l'empire des paysans mayas.
Le professeur genevois Jean Ziegler, membre du Conseil des droits de l’homme (actuellement présidé par l’illustre Royaume de l’Arabie Saoudite), a rédigé moult commentaires sur cette affaire. Et il a mis au point ce sentiment : Ziegler décrit Sperisen comme le descendant de grands propriétaires fonciers sans scrupules qui, comme « chef de la police tout puissant » au service de l'oligarchie, a asservi de pauvres paysans indigènes par des « actions de nettoyage social » et qui, «grâce au travail pointu et énergique d'organisations non gouvernementales», est finalement tombé. Cela correspond bien aux clichés que l’on croit connaitre des films hollywoodiens – mais a peu à voir avec la réalité qui se cache derrière.
Prochaine suite : L'histoire d'une famille d'émigrants originaires de Zuchwil (Soleure) et d’Erwin Sperisen, qui commence sa carrière chez les pompiers volontaires de Guatemala.
2. L’Odyssée du clan Sperisen
29.10.2015 - Pour protéger sa famille contre les gangsters, l'ancien chef de la police guatémaltèque, Erwin Sperisen, est revenu dans la patrie de ses ancêtres. Mais, en Suisse, il a bientôt lui-même atterri en prison en raison d'une campagne politique et un soupçon collectif s’abat sur toute sa famille.
Depuis trois ans et deux mois, le monde d'Erwin Sperisen est rectangulaire, il se compose d'un lit rudimentaire, d'une chaise et d'une table et mesure exactement 10,18 mètres carrés. C'est la taille d'une cellule dans la maison d'arrêt genevoise de Champ-Dollon. Une fois par jour, ce géant de presque deux mètres est autorisé à quitter sa cellule pendant une heure pour se dégourdir les jambes dans une cage plus grande. Il n'a aucun contact avec d'autres prisonniers. Car, à en croire la justice genevoise, Sperisen serait un homme dangereux.
Deux heures par semaine, Erwin Sperisen est autorisé, sous bonne garde, à voir sa femme Elisabeth et ses enfants. Cette économiste jadis appréciée vit désormais de l'aide sociale et partage un deux pièces avec ses trois enfants. Mais même cela semblait encore trop aux autorités genevoises, qui ont voulu, l'an dernier, expulser Elisabeth Sperisen du pays. Contrairement à son mari et à ses enfants, elle n'a pas de passeport suisse.
C'est la fin cruelle d'une saga d'immigrants de Niederwil, dans le canton de Soleure. Elle a commencé voilà 90 ans. Après la fin de l'école de recrues, Franz Sperisen est d'abord parti tenter sa chance comme employé de bureau en Belgique en 1925. Trois années plus tard, il traversait l'Atlantique à bord du «SS Orion» aux côtés d'un ami qui mourut du typhus peu après leur arrivée au Guatemala. Franz Sperisen trouva du travail comme régisseur dans diverses plantations de café. Douze années plus tard, après avoir suffisamment économisé, il fit venir de Lucerne Babette Jurt, sa future épouse.
L'histoire des Sperisen est celle de dizaines de milliers de Suisses qui partirent, au début du siècle dernier, chercher une vie meilleure dans le Nouveau Monde. Horlogers, boulangers, hôteliers, entrepreneurs ou agriculteurs, les «suizos» jouissent jusqu'à aujourd'hui d'une excellente réputation dans toute l'Amérique latine. Certains ont même accédé à la célébrité. Jacobo Arbenz, par exemple, fils du pharmacien Jakob Arbenz d'Andelfingen, un ami de Franz Sperisen, a été élu en 1950 président du Guatemala. Mais la grande majorité des 1189 Suisses qui résident actuellement au Guatemala appartient à la classe moyenne. Comme les Sperisen.
Franz et Babette Sperisen fondèrent une vitrerie à Guatemala-City. Franz étant atteint d'un cancer, le couple rentra en Suisse avec ses trois enfants en 1958. Ils perdirent l'entreprise. Edi avait alors dix ans. Tandis que ses frères et sœurs restèrent en Suisse, il retourna au Guatemala dès qu'il eut terminé l'école de recrues. Il y fit la connaissance de sa femme Linda, une Guatémaltèque pleine de fougue d'origine américaine, qui lui donna quatre fils. Erwin, né en 1970, aujourd'hui prisonnier à Champ-Dollon, est l'aîné.
Edi et Linda Sperisen ont aussi commencé tout en bas de l’échelle, d'abord avec une vitrerie, puis une menuiserie, qui s'est transformée au fil des ans en une petite usine. A son apogée, 350 ouvriers y produisaient des meubles de jardin exportés aux États-Unis. Pour lutter contre les pertes de temps de la bureaucratie, Sperisen fonda avec d'autres exportateurs un groupement d'intérêts qu'il présida avec succès. C'est ainsi qu'il entra progressivement en politique.
Alvaro Arzú fit de Sperisen, en 1996, le vice-ministre de son gouvernement de centre-droite. Arzú, élu aussi à plusieurs reprises maire de Guatemala-City, est respecté de tous les partis pour son engagement en faveur de la démocratie et pour l'accord de paix signé avec les guérillas. C'est aussi Arzú qui envoya plus tard Edi Sperisen comme ambassadeur à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) à Genève, où il occupe encore aujourd'hui une fonction dirigeante.
1996 fut une année d'espoir, mais aussi de désillusion au Guatemala. L'accord de paix à peine signé avec les guérillas, ces dernières enlevèrent un descendant du clan Sperisen. Le jeune homme travaillait comme agronome dans une finca. Erwin Sperisen, alors âgé de 26 ans, apporta la rançon aux gangsters dans la jungle. Que justement Erwin se soit chargé de cette dangereuse mission était, selon sa mère Linda, tout à fait lui. Son aîné était depuis l'enfance un idéaliste sans peur, qui commandait et protégeait ses trois plus jeunes frères, leur père étant souvent absent pour des raisons professionnelles.
L'enthousiasme de Sperisen pour les pompiers volontaires, dans les rangs desquels il est entré à l'âge de seize ans, cadre bien avec cette image. En dehors, peut-être, de sa passion pour les grosses motos, dont il a hérité de sa mère Linda, sa biographie n'a pas grand-chose d'extravagant. Tandis que les jeunes gens de son âge jouaient au foot ou couraient après les filles, Erwin, le géant aux cheveux roux, s'engageait adolescent pour le mouvement libéral de droite, le PAN, des futurs présidents Alvaro Arzú et Oscar Berger. Son père était déjà un sympathisant de leur politique.
Logiquement, Erwin Sperisen fit des études de sciences politiques à l'Université Francisco Marroquín. Il y fit la connaissance d'Elisabeth, une Salvadorienne aux ancêtres suisses. Elle dit que ce fut le coup de foudre. En dehors des racines helvétiques et de l'intérêt pour la politique, les questions économiques et sociales, ils avaient un autre point commun: Erwin (1,94 m) et Elisabeth (1,84 m) sont vraiment très grands pour la norme guatémaltèque.
Extérieur au sérail et à la morale de fer
Tous deux ont eux-mêmes financé leurs études. Alors qu'Elisabeth travaillait pour un think-tank libéral, l'ancien maire de Guatemala-City et futur président Oscar Berger faisait entrer l'ambitieux jeune Sperisen dans son administration. Ils se marièrent en 1997 et le premier de leurs trois enfants naquit trois ans plus tard. Elisabeth Sperisen continua pourtant de travailler. Cela explique aussi pourquoi le jeune couple put s’offrir une modeste maison dans un quartier de la moyenne bourgeoisie et se permettre d'envoyer leurs enfants dans une école allemande relativement onéreuse.
En juillet 2004, Erwin Sperisen reçut du Palais du gouvernement un appel assez surprenant qui allait bouleverser la vie de toute la famille: le ministre de l'Intérieur Carlos Vielmann, arrivé au pouvoir avec Oscar Berger quelques mois auparavant, voulait faire de Sperisen le chef politique de la Policía Nacional Civil (PNC). Une folle entreprise. Comment Sperisen, sorti de l'université, qui n'avait aucune idée du travail policier et dont la seule expérience de commandement se limitait à celle des pompiers volontaires allait-il pouvoir contrôler un corps de 22 000 policiers?
La police guatémaltèque a une réputation abominable, elle passe pour corrompue et fait souvent cause commune avec les gangs. Or c’est précisément pour son manque patent de relations que Vielmann et Berger ont misé sur Sperisen: seul quelqu'un d'extérieur au sérail et à la morale de fer, doté d'un fort idéalisme, pouvait mettre de l'ordre dans cette troupe chaotique où personne ne faisait confiance à personne. Si tant est que cela fût possible.
Ses frères, ses parents, ses amis ont tenté de dissuader Erwin Sperisen de cette mission impossible. Il faut aussi savoir que la longévité en poste d'un chef de la police au Guatemala est de quelques semaines, au mieux de quelques mois – passé ce délai, il doit, dans le meilleur des cas, démissionner à cause d'un scandale quelconque; dans le pire des cas, il est tout simplement abattu. Le maire Fritz García Gallont, son plus grand soutien jusqu'à cette date, invita spécialement Erwin Sperisen à un petit déjeuner pour le dissuader de cette mission suicide. Mais les objections semblaient plutôt le motiver. «Quand Erwin est convaincu d'une chose, les suppliques et les menaces ne servent à rien, il le fait, » dit sa femme Elisabeth.
Début août 2004, Erwin Sperisen a pris ses fonctions. Le premier scandale s'est à peine fait attendre quatre semaines. Sur les ordres de la Cour suprême, la Policía Nacional dut évacuer à la fin août la finca Nueva Linda, une ferme située à Retalhuleu, sur la côte pacifique, qui avait été occupée dans le cadre d'un conflit complexe entre deux organisations paysannes par plus d'un millier d'insurgés en partie armés. Lors de la confrontation, six paysans et trois policiers ont perdu la vie. 22 policiers ont été blessés par balles et, s'ils n'avaient pas porté des gilets pare-balles occidentaux, il y aurait à coup sûr eu plus de pertes à déplorer du côté des policiers.
Sperisen aurait-il dû ignorer l'ordre d'évacuation de la justice? Ses troupes auraient-elles dû refuser la confrontation armée? Au Guatemala où l'on en avait plus qu'assez de la terreur exercée par des bandes armées, ces questions étaient rhétoriques. Sperisen, chef de la police, n'avait directement que peu à voir avec cette opération sanglante. Pourtant, elle lui valut la haine éternelle des milieux tiers-mondistes parfaitement connectés sur le plan international. Les organisations caritatives de gauche ont fait de l'affaire de la «finca Nueva Linda» un tremplin qui servirait plus tard à lancer la chasse contre Sperisen en Suisse.
Enlèvement de son fils déjoué
A cette époque, Erwin Sperisen avait, à vrai dire, bien d'autres soucis. Il misait dans la lutte contre la corruption en partie sur de meilleures conditions de travail qui devaient permettre de créer un lien plus étroit entre les policiers et leur corps d'appartenance. Une réforme du système de santé dans la police était débattue, en plus des pensions accordées aux veuves et aux orphelins de policiers assassinés. Ce fut la raison pour laquelle Sperisen fit son adjoint de son ami de jeunesse Javier Figueroa, qu'il avait connu chez les pompiers. Figueroa était médecin. La connaissance du domaine tombait, aussi, fort bien pour le second volet important des réformes: Sperisen voulait permettre à la police de se doter enfin d'un service moderne de médecine légale et de criminalistique.
Sperisen est parvenu à rester en poste pendant près de trois ans – un record dans le contexte guatémaltèque. Pour sa femme et ses enfants, qui ne pouvaient plus se déplacer qu'entourés de gardes du corps lourdement armés, ce fut une période difficile. Après la tentative d'enlèvement avortée d'un de ses fils en 2006, Elisabeth Sperisen a déménagé avec ses trois enfants chez ses beaux-parents à Genève. Erwin Sperisen est venu les rejoindre au printemps 2007. Après un scandale impliquant quatre policiers guatémaltèque qui avaient assassiné trois parlementaires salvadoriens dans le cadre d'un trafic de cocaïne et qui furent ensuite eux-mêmes assassinés en prison, il avait démissionné de ses fonctions.
Le couple Sperisen pensait rester seulement six mois à Genève, le temps nécessaire pour que l'affaire se tasse au Guatemala. Mais, dans l'intervalle, Elisabeth avait trouvé un très bon poste à l'ONU, les enfants s'étaient vite habitués à Genève, et les grands-parents étaient aussi heureux de voir la famille réunie. Erwin Sperisen avait en vue un emploi à Interpol à Lyon, où l'on avait pris acte avec bienveillance de son engagement au Guatemala. Tout semblait sur la bonne voie. C'était sans compter sur la campagne de diffamation que tramaient depuis longtemps en coulisses des groupuscules de gauche des milieux tiers-mondistes (Uniterre, Acat, OMCT, TRIAL) contre Sperisen (Weltwoche No 43/15 – «La confusion genevoise»).
Le changement de cap politique qui se produisit en 2008 au Guatemala a certainement aussi joué un rôle: après deux décennies de gouvernement libéral modéré, le social-démocrate Álvaro Colom a pris les rênes du pouvoir. Le fait que les nouveaux détenteurs du pouvoir couvrent leurs prédécesseurs de plaintes au pénal, qui n'aboutissent jamais, appartient au folklore politique au Guatemala. Entre-temps, la CICIG avait aussi démarré son travail. Cette organisation, notamment cofinancée par la Suisse, à laquelle Berger avait fait appel, avait pour objectif d'apporter son soutien à la justice pénale guatémaltèque. Sous le régime de Colom, la CICIG s'est immédiatement emparée de l'affaire de sept détenus abattus par les forces de sécurité en septembre 2006, au cours d'un raid de grande ampleur dans la prison El Pavón.
En août 2010, la CICIG a engagé des poursuites avec des procureurs guatémaltèques contre dix-huit responsables du gouvernement Berger, dont de hauts fonctionnaires, qui avaient participé d'une manière ou d'une autre à l'assaut d'El Pavón. Sperisen et son adjoint Javier Figueroa figurent aussi sur la liste aux côtés du ministre de l'Intérieur Vielmann et du directeur du système pénitentiaire Alejandro Giammattei. Il est révélateur que les procureurs directement impliqués aient été épargnés.
Nous reviendrons sur les accusations dans le prochain épisode. Disons simplement, pour l'instant, que l'enquête menée au Guatemala est pleine de contradictions, d'incertitudes et de lacunes. Et qu’elle se fonde sur des deals de clémence, illégaux en Suisse. Tout le dossier est empreint d'aspects plus politiques que juridiques. Sans compter qu'il en va aussi des réparations financières demandées dont les montants sont astronomiques d’un point de vue guatémaltèque.
En raison des accusations portées contre lui, Erwin Sperisen n'avait plus de perspectives d'emploi. Il n'a plus eu de nouvelles d'Interpol. Il était homme au foyer. Peu de temps après la mise en accusation, Elisabeth a perdu son poste à l'ONU. On ne lui a pas donné de raison officielle, mais la cause est évident : son épouse. C'est l'un des épisodes les plus amères de cette tragédie: un soupçon collectif s’abat sur les Sperisen. Le père, Edi Sperisen, en a aussi ressenti les conséquences: du fait de sa double nationalité, Berne menaçait soudain de lui retirer son statut diplomatique. Il a remis son passeport suisse aux autorités. Le reste est connu. Erwin Sperisen a été arrêté en pleine rue, en août 2012, en dépit de s'être présenté de son plein gré auprès du Ministère public de Genève et d'avoir proposé sa coopération.
Le procureur genevois Yves Bertossa, étroitement lié à l'ONG TRIAL, a justifié l'arrestation spectaculaire par le risque de fuite. Où Sperisen aurait-il pu s'enfuir – mystère? Au Guatemala, où son soi-disant complice Alejandro Giammattei venait d'être acquitté? En Autriche, où Javier Figueroa, son supposé conjuré, venait aussi d'être acquitté en 2013 au cours d'un long procès aux assises dans exactement la même affaire?
«La cour d'assises autrichienne n'avait en fait pas de connaissances du dossier», a déclaré le procureur Bertossa en mai dernier devant la Cour d'appel de Genève. Le fait est que les jurés en Autriche ont rendu leur verdict uniquement sur la base de témoignages directs de personnes en chair et en os. Les juges du dossier à Genève se sont en revanche appuyés pour les points essentiels sur des enquêtes polluées par la politique dans le lointain Guatemala, dont personne ne sait exactement avec quels moyens elles ont été effectuées. L'histoire, le caractère et les motivations d'Erwin Sperisen sont aussi évacués dans le verdict genevois par quelques formules creuses. Pour la justice genevoise, il n'est rien d'autre qu'une figure abstraite qui permet de statuer un exemple. Dans ces circonstances, il est nettement plus facile de prononcer un jugement de condamnation à perpétuité pour multiples meurtres.
L'imagination de Jean Ziegler
«Justice et raison sont parvenues à triompher», a exulté le professeur genevois Jean Ziegler après le verdict. Grâce au «travail pointu et énergique d'organisations non gouvernementales», on a soi-disant fait tomber un descendant et un laquais des «oligarques scandaleusement riches». Avec une «violence impitoyable», d'après Ziegler, le «chef tout puissant de la police» s'en est pris à de «miséreux journaliers insurgés, à des ouvriers mourant de faim et à des syndicalistes contestataires». On ne peut dépeindre plus justement l'univers intellectuel dans lequel le verdict s'est formé. Le professeur affabule même en parlant de «sept jeunes gens» que Sperisen aurait personnellement exécutés parce qu'ils avaient protesté «contre les mauvais traitements infligés par les gardiens». Mais l'imagination de Ziegler est à 6000 lieues de la réalité guatémaltèque.
3. Une expérience épouvantable
5.11.2015 - La justice genevoise veut emprisonner Erwin Sperisen à vie pour sa participation supposée à des exécutions au Guatemala. Mais le dossier est truffé d'incohérences. La pression politique pour condamner Sperisen, en dépit d'innombrables contradictions, était plus forte que tous les doutes.
L'appel du Ministère de l'Intérieur était totalement inattendu pour Alejandro Giammattei. C'était fin octobre 2005. Giammattei pressentait qu'il pouvait être en lien avec l'évasion de dix-neuf criminels de la prison de haute sécurité El Infiernito. Le scandale avait contraint le ministre de l'Intérieur Carlos Vielmann à agir. Mais le fait que Vielmann veuille faire de lui le plus haut responsable des prisons au Guatemala surprenait toutefois Giammattei, médecin de son métier. Il objecta qu'il ne connaissait rien au système pénitentiaire. «C'est exactement le profil que nous recherchons», répliqua le ministre, «quelqu'un d'extérieur pour secouer ce système corrompu sur toute la ligne».
Giammattei demanda une semaine de réflexion. Tous ses amis et ses proches le lui déconseillèrent. Le système pénitentiaire au Guatemala était dans un état pitoyable. On le mit en garde: mettre de l'ordre dans ce système serait une tâche surhumaine à laquelle une personne honnête ne pouvait que se brûler les ailes. Avant de prendre une décision, Giammattei voulait voir les quatre principales prisons de l'intérieur. Vielmann accéda à son souhait.
L'expérience faite par Giammattei au cours de son périple à la découverte des prisons guatémaltèques dépassa ses pires craintes et fait l'objet d'un livre* qu'il a écrit plus tard. Morts dues au crack, prostitution, armes, violence et agressions sexuelles étaient le lot quotidien dans les prisons. Le personnel pénitentiaire avait démissionné depuis longtemps et ne tentait même plus de changer le cours des choses.
Prison modèle comme le centre du crime organisé
Dans la Granja Modelo de Rehabilitación Penal El Pavón, la prison modèle, la situation était particulièrement dégradée. Le médecin découvrit un système qui évoque le souvenir de l'esclavage. La prison était sous le contrôle de gangs. Pour dormir dans un lit, il fallait payer – et celui qui ne le pouvait pas devait se mettre au service des gangsters. Les nouveaux détenus étaient vendus aux enchères aux boss de la prison. Les désobéissances étaient punies brutalement, dans certains cas par la mort.
El Pavón avait été construite dans les années 70 comme une prison modèle avec sa propre exploitation agricole et des ateliers. Les détenus avaient une certaine autonomie encadrée par le Comité pour l'ordre et la discipline (COD). Mais le COD avait depuis longtemps pris le contrôle de la prison et chassé les gardiens de l'enceinte. L'accès au terrain n'était pas fermé de l'extérieur, mais de l'intérieur. Le personnel pénitentiaire travaillait de facto à la solde de barons de la drogue qui leur versaient des «salaires» beaucoup plus élevés que l'État.
Le modèle de participation s'était transformé en une expérience épouvantable, qui n'a pas d'égale. Giammattei constata certes que le régime très hiérarchisé de la prison fonctionnait étonnamment bien. Il y avait même une sorte de cadastre. Celui qui pouvait se le permettre vivait dans son propre chalet avec tout ce que cela implique: jacuzzi, téléphones antiécoutes, personnel de maison et gardes du corps. Mais les ateliers des faussaires, les laboratoires de stupéfiants et les garages où les voitures volées étaient maquillées étaient, aussi, très bien organisés. Des gangs de voleurs, de trafiquants de drogue et de ravisseurs opéraient en toute liberté et en toute impunité à partir d'El Pavón. On y cachait même dans certains cas des personnes enlevées. La police a trouvé des indices que des films pornos avec des enfants et de SM avaient été produits à El Pavón. En 2003, deux policiers trouvèrent la mort en tentant de poursuivre des délinquants à l'intérieur de la prison.
«Celui qui y entre comme criminel en ressort sociopathe», comme l'a déclaré Giammattei. Finalement, ce fut une observation fortuite qui poussa le médecin à accepter: il avait constaté que les visiteuses subissaient des palpations des parties intimes sans protection hygiénique. Ne pas avoir contracté de maladie sexuellement transmissible après une fouille corporelle relevait de la chance. Le médecin était atterré – et il a dit oui. Dès le jour de sa passation de pouvoirs, il a subi son baptême du feu: une mutinerie dans la prison des femmes Santa Teresa. Les détenues demandaient un assouplissement du régime des visites masculines. Grâce à son intervention personnelle sur place, Giammattei parvint à mettre fin pacifiquement à la rébellion.
Le fatalisme dans l'appareil administratif était abasourdissant. Pour commencer, Giammattei a tenté de remplacer l'équipe de direction. Une entreprise désespérée. Il a proposé à 58 amis et personnes de confiance des postes clés, tout le monde lui a souhaité bonne chance, pas un seul n'a accepté. Giammattei a encouragé le procureur spécial pour les Droits de l'homme, Sergio Morales, à ouvrir une agence à El Pavón. Morales a sèchement rejeté la proposition. L'intérêt du médiatique procureur spécial pour les Droits de l'homme pour les victimes anonymes de la violence quotidienne était manifestement limité. Il deviendrait par la suite l'un de ses plus farouches adversaires.
L'enregistrement électronique des détenus était un sujet important. Personne ne connaissait précisément leur nombre. Il y avait à l'évidence des détenus qui avaient purgé leur peine depuis longtemps et dont la fiche s'était perdue dans le système. Giammattei se fixa comme objectif à moyen terme de ramener les prisons sous le contrôle de l'État. Il décidait commencer par les 1800 détenus d'El Pavón. Et, comme l'opération était militaire, le nouveau chef chargea de sa planification un homme du service de renseignement militaire: Luis Linares Pérez. Cet agent secret reçut également l'ordre d'infiltrer des informateurs à l'intérieur d'El Pavón et d'établir une liste des principaux meneurs qui seraient répartis dans d'autres prisons. On affirmera plus tard qu'il s'agissait en réalité d'une liste d'exécution.
José Hernández, la première victime
Le 18 juillet 2006, la situation s'envenime à El Pavón. Luis Zepeda, le roi autoproclamé de la prison, envoie un ultimatum: 57 détenus, qui manifestement sont trop peu rentables, doivent immédiatement quitter la prison, faute de quoi il ne peut répondre de rien. En clair, cela signifie que ces hommes seront assassinés. Giammattei rejette le chantage. Le 11 septembre, un des détenus disgraciés, José Hernández, est assassiné. Le temps presse.
Le 25 septembre 2006, tout est prêt: à l'aube, 2500 forces d'intervention – armée, police, commandos spéciaux, personnel pénitentiaire – sont déployées et encerclent, selon le plan de Linares Pérez, le terrain d'El Pavón. A 5 heures du matin, les détenus sont invités par haut-parleurs à quitter les bâtiments et à se rassembler sur les terrains de sport. Alejandro Giammattei suit l'opération aux côtés du chef de la police, Erwin Sperisen, dans la salle de commandement située à l'entrée principale, sur le côté nord. A 6 heures du matin, l'alimentation électrique est coupée. Une demi-heure plus tard débute l'assaut d'El Pavón.
Sur le côté sud du vaste terrain, les troupes d'intervention ouvrent deux brèches dans la clôture et donnent l'assaut de la prison sur deux flancs. Près du chalet du baron colombien de la drogue Jorge Batres, une fusillade, qui durera environ 20 minutes, éclate vers 7 heures. Sperisen se trouve alors avec son groupe à l'opposé du terrain, côté nord, près de l'entrée principale. Ce n'est qu'à 7 heures 40 qu'il se rend sur le côté sud-est, comme les enregistrements vidéo le prouvent. C'est au plus tard à ce moment-là qu'il apprend qu'il y a sept détenus abattus dans le chalet de Batres. Le baron de la drogue lui-même ainsi que le roi de la prison Luis Zepeda se trouvent parmi les morts.
Aux alentours de 8 heures, le ministre de l'Intérieur Vielmann pénètre sur le terrain, suivi de plusieurs journalistes et procureurs. Vers 10 heures, plusieurs équipes du Ministère public commencent le relevé des empreintes et l'évacuation des morts dans le chalet de Batres. Aux environs de 11 heures, les autorités impliquées informent sur l'«opération Pavo Real» au cours d'une conférence de presse. Les médias guatémaltèques sont unanimes pour qualifier le raid de succès, même si l'on suspecte rapidement que, pour le moins, certains des sept morts pourraient avoir été exécutés de sang-froid.
Certains éléments vont dans ce sens. Pas un seul policier n'a été blessé au cours de la fusillade, en revanche, les sept détenus sont morts sur le champ. Dans la mesure où l'on peut se fier aux relevés rudimentaires et bâclés des empreintes du Ministère public, de nombreuses blessures par balles relevées sur les corps cadrent mal avec un échange de tirs. On trouve sur deux cadavres des marques aux poignets qui pourraient provenir de menottes. Les noms de plusieurs morts figureraient sur la liste des détenus les plus influents que l'agent secret Linares Pérez dit avoir établie. On ne peut pas le prouver, car la sinistre liste n'a jamais été retrouvée.
Au moment de la fusillade, le chef de la police Sperisen n'était pas sur place, comme l'attestent des enregistrements vidéo, mais bien son adjoint Javier Figueroa. Les images montrent en outre que des commandos spéciaux masqués, sans insignes de grade, ont donné l'assaut au chalet de Batres. Il devrait s'agir des «Riveritas», une unité spéciale portant le nom de son chef Victor Rivera, placée directement sous les ordres du Ministère de l'Intérieur. Malheureusement, Rivera ne peut plus rien dire à ce propos, il a été assassiné en 2008. Les dépositions d'autres membres du commando n'ont jamais été transmises à Genève en dépit des demandes.
Théoriquement, l'opération Pavo Real était top secrète, mais, dans les faits, elle avait été révélée dans les moindres détails, la veille, par un journal. Les détenus savaient donc à quoi s'attendre. L'assaut d'El Pavón a été suivi par de nombreux journalistes. Exécuter sept personnes sous les yeux de centaines de témoins, en passant inaperçu, était par conséquent assez difficile. Mais il est pensable que les Riveritas aient profité du chaos de la fusillade autour du chalet de Batres pour procéder à des exécutions ciblées. A supposer que cette thèse soit exacte, une question beaucoup plus difficile se pose: qui a donné l'ordre? Des bandes rivales, en passant par les services secrets et l'armée, jusqu'au gouvernement, tout est possible – et rien n'est prouvable.
Lorsque la commission internationale CICIG et le procureur spécial pour les Droits de l'homme déjà mentionné, Sergio Morales, ont démarré les enquêtes après le changement de gouvernement en 2008, ils se sont concentrés sur les responsables politiques: le ministre de l'Intérieur Vielmann, le directeur du système pénitentiaire Giammattei, le chef de la police Sperisen et son adjoint Figueroa. En revanche, les procureurs, les commandos spéciaux et les militaires impliqués n'ont pas été inquiétés. La CICIG et Morales voulaient manifestement envoyer un signal politique. Mais justice et politique ne font pas bon ménage.
Une responsabilité politique ne fonde pas pour autant une culpabilité pénale. Le livre de Giammattei illustre clairement l'impuissance des titulaires de charges politiques. Le médecin a été reconnu non coupable et acquitté en 2012 au Guatemala, au terme d'une année de détention provisoire, c'est aussi le cas de plusieurs policiers. Il s'en est suivi en 2013 l'acquittement de Figueroa, au demeurant aussi médecin, en Autriche. La procédure contre le ministre de l'Intérieur Vielmann est au point mort en Espagne. Le seul à avoir été frappé est Sperisen, le chef de la police. La Cour d'appel de Genève l'a condamné en mai dernier pour de multiples meurtres à la réclusion à perpétuité (Weltwoche No 43/2015 – «La confusion genevoise»).
Erwin Sperisen n'a pas exclu lors son procès à Genève que des exécutions pouvaient avoir eu lieu lors de l'assaut d'El Pavón. Il nie seulement y avoir été associé. L'intervention policière a été planifiée et dirigée par le commandant responsable; en tant que chef politique de la police, Sperisen n'avait aucune influence directe sur l'opération. Son apparition martiale – Sperisen s'est fait photographier sur place en uniforme et lourdement armé – était juste pour le décor. Il voulait ainsi envoyer un signal politique: une déclaration symbolique de guerre adressée au crime organisé. Il n'est jamais intervenu au cours de l'enquête sur les décès, tout simplement parce que cela lui était interdit. C'était le travail du Ministère public qui était sur place depuis le début.
Or le chef d'accusation ne porte pas sur une fanfaronnade, mais sur plusieurs assassinats. Dans la lointaine Genève, les explications de Sperisen sont tombées sur des oreilles de sourd. «Sur le champ de bataille, ce sont les chefs qui commandent», s'est écrié le procureur Yves Bertossa pendant les débats d'appel dans la salle d'audience, «et les exécutants exécutent »! Voilà qui pourrait parfaitement résumer le verdict. Les juges n'ont pas tranché sur ce que Sperisen est censé avoir fait précisément. Il leur était tout simplement impossible d'imaginer que les meurtres présumés aient été planifiés et exécutés à l'insu du chef politique.
L'obscure accusation selon laquelle Sperisen aurait lui-même abattu des détenus n'a certes pas été reprise en deuxième instance. Tandis que la Cour criminelle présumait encore une participation active du chef de la police aux exécutions, la Cour d'appel lui reprochait le contraire: la passivité de Sperisen aurait été révélatrice, il ne se serait pas intéressé aux noms des morts, pas plus qu'il n'aurait ordonné une enquête sur cette affaire.
Les dossiers judiciaires comportent actuellement tout un bouquet de témoignages, apparemment aussi coloré, déroutant et impénétrable que la jungle guatémaltèque. De nombreuses déclarations se contredisent. Pas même le procureur Yves Bertossa n'a voulu se prononcer en faveur d'une version concrète. L'acte d'accusation pas plus que le jugement ne disent quand et où Erwin Sperisen aurait donné quels ordres et à qui. Il est supposé avoir comploté à un certain moment d'une certaine manière avec Giammattei et Figueroa pour donner quelque part à quelqu'un l'ordre de tuer.
Un accusation kafkaïenne
Le côté perfide de l'acte d'accusation de Bertossa réside dans le fait qu'il est difficile de se défendre contre un reproche que l'on ne connaît pas avec exactitude. Les défenseurs Florian Baier et Giorgio Campá n'ont certes pas ménagé leurs efforts et mis en évidence une incohérence après l'autre. Mais, à partir de l'énorme montagne de rapports et de témoignages venus du lointain Guatemala, dont on ne peut même pas vérifier la crédibilité, on peut prouver tout et son contraire. Baier et Campá ont aussi trouvé des indices qui indiquent que les enquêteurs guatémaltèques ont dissimulé à leurs confrères genevois des éléments à décharge.
Une chose est certaine: la pression pour obtenir des résultats qui pesait sur l'organisation internationale CICIG, chargée avec les procureurs guatémaltèques des enquêtes sur place en 2008, était énorme. Son seul objectif, la «lutte contre l'impunité», exigeait des résultats rapides, d'autant plus que le mandat de la CICIG était, dès le départ, limité à deux ans. Dans l'urgence, on a donc recouru à une méthode, usuelle aux États-Unis, mais tout simplement illégale en Suisse ainsi qu'au Guatemala: les accords de clémence.
Les personnes qui ont dénoncé un supérieur hiérarchique auprès de la CICIG ont non seulement bénéficié d'un programme de clémence, mais aussi en prime de l'impunité. La culpabilité avec ce système remonte en cascade du bas vers le haut: pour sauver sa propre tête, chacun dénonce l'échelon hiérarchique juste au-dessus. En partant de tout en bas de l'échelle, les enquêteurs remontent jusqu'au big boss qui, à la fin, doit payer pour tous. Ce qui peut, à première vue, sembler séduisant est en vérité tout bonnement corrompu. Le risque est trop grand qu'un suspect ne cherche à se disculper en dénonçant de mauvaise foi un innocent.
Dans l'affaire d'El Pavón, le risque de dénonciations calomnieuses est particulièrement fort, vu que faute de preuves matérielles fiables, les dépositions des témoins ont un poids excessif. A cela s'ajoute le fait qu'un policier condamné pour le meurtre de détenus a peu de chances de survivre dans une prison guatémaltèque. C'est comme avec la torture: la peur de la mort stimule l'imagination à mesure que diminuent les réticences à faire de fausses accusations. Les accusations et les aveux, qu'ils soient forcés ou achetés, ne valent donc même pas le prix du papier sur lequel ils ont été consignés.
Comme il est ressorti du procès en Autriche, l'enquêtrice de la CICIG, Gisela Rivera, a fait au médecin et adjoint de Sperisen, Javier Figueroa, une généreuse promesse de remise de peine si ses dépositions allaient dans le sens qu'elle en attendait. D'après le magazine Profil, elle avait déjà rédigé ses «aveux», mais Figueroa a refusé d'y apposer sa signature. En 2009, l'enquêtrice de la CICIG a fui précipitamment au Costa Rica, son pays d'origine. Le Guatemala a lancé un mandat d'arrêt international à son encontre pour violation du secret de fonction, contrainte et entrave à l'action pénale. Mais la procédure contre les prétendus conspirateurs d'El Pavón était depuis longtemps enclenchée, il n'était plus possible de revenir sur les accusations extorquées.
Alejandro Giammattei s'est aussi vu proposer un accord de clémence: une peine de seulement cinq ans d'emprisonnement, qu'il n’accomplirait jamais, contre des «aveux» qui devaient impliquer le ministre de l'Intérieur Vielmann. Il refusa et passa un an en détention provisoire avant d’être libéré. Malheureusement, le tribunal de Genève a refusé d'entendre Giammattei comme témoin. Cela aurait rendu plus difficile la condamnation.
En revanche, l'agent secret Luis Linares Pérez, qui avait planifié l'assaut d'El Pavón et dressé la sinistre liste des détenus les plus influents, fut amené à Genève. Linares Pérez a principalement témoigné à charge contre son commanditaire Giammattei ainsi que contre Figueroa, Sperisen n'apparaît qu'en marge dans ses dépositions. Il prétend ne rien avoir à faire avec le complot qu'il n'aurait découvert qu'ultérieurement. Bizarrement, Linares Pérez, qui prétend n'avoir été au courant de rien, était présent lors de la fusillade devant le chalet du baron de la drogue Batres. Toutefois, selon sa version, il n'aurait tiré que trois coups de feu. Ensuite, ses propres hommes l'auraient jeté à terre et désarmé.
Les témoins forcés
Comme les défenseurs Baier et Campá l'ont découvert au cours de la procédure, la déposition de Linares Pérez avait aussi été achetée contre un accord de clémence. Il vit aujourd'hui au Canada. Pour douteuses que soient les dépositions de l'agent secret – c'est sur elles que se fonde l'accusation de complot criminel entre Giammattei, Figueroa et Sperisen. Mais comme Sperisen, selon cette version, a joué un rôle plutôt subalterne, la justice genevoise a rapidement déclaré coupables les médecins qui avaient déjà été acquittés. Il était autrement impossible de condamner Sperisen.
Le 26 mars 2015, peu avant les débats d'appel dans l'affaire Sperisen, le maire genevois Sami Kanaan a remis la médaille d'honneur («Genève reconnaissante») à l'organisation TRIAL pour ses mérites dans le cadre de la poursuite de la criminalité politique. Membre d'un réseau international d'ONG de gauche, l'organisation TRIAL avait déclenché la procédure contre Sperisen en Suisse et s'était chargée d'en faire la propagande. Lorsqu'Erwin Sperisen s'est présenté à la barre, son verdict était arrêté depuis longtemps. Le besoin de faire un exemple était impérieux.
*Alejandro Giammattei Falla: El caso Giammattei. Relato de una injusticia.
Kindle. 468 S., ISBN 978-9929-40-280-5.
4. «Un cauchemar interminable»
21.12.2017 - Après cinq ans de détention preventive, Erwin Sperisen a été libéré en septembre dernier sur ordre du Tribunal fédéral. Dans une interview accordée à Weltwoche, l'ancien chef de la police guatémaltèque parle de sa relation à la Suisse, des expériences qu'il a faites avec la justice genevoise, des 1849 jours d'isolement carcéral, de sa famille – et de la responsabilité non éclaircie de l'exécution des sept détenus dans la prison El Pavón.
Le Palais de Justice fait majestueux dans la lumière chaude du soleil d'automne, des cris d'enfants qui jouent et des aboiements de chien montent de temps à autre de la Promenade Saint-Antoine, aux terrasses des cafés de la Cité règne une convivialité tranquille, au loin le Jet d'eau jaillit dans le ciel. Quand Erwin Sperisen regarde par la fenêtre de son appartement, la ville de Genève se présente sous un côté charmant, presque kitsch.
Le monde derrière la façade de l'appartement de Sperisen dans la vieille ville est un peu moins agréable. Les parents partagent une petite chambre, les trois enfants dorment dans la cuisine-salle à manger. Le service social de Genève n'accorde pas plus à la famille Sperisen dont on aurait bien aimé se débarrasser depuis longtemps. Mais Erwin Sperisen ne peut pas déménager. Un bracelet électronique l'en empêche. Et il ne veut pas non plus déménager. Car il se bat pour sa réhabilitation. Une question d'honneur et de principes.
Le procureur de Genève, Yves Bertossa, pensait s'en tirer facilement lorsqu'il a fait arrêter l'ex-chef de la police du Guatemala le 31 août 2012. Un repenti et des documents d'Amérique centrale devaient prouver qu'Erwin Sperisen avait assassiné sept prisonniers dans son pays en 2006. Comme il n'était pas possible d'extrader au Guatemala ce binational suisse, Bertossa l'a traduit en justice à Genève.
Mais le procès Sperisen s'est rapidement converti en cauchemar juridique. Les documents du Guatemala pollués par des magouilles politiques ne valaient même pas le papier sur lequel ils étaient écrits, regorgeaient de contradictions. Les repentis, achetés à coup de privilèges et de remises de peine, que l'on avait fait venir en avion du Guatemala à grands frais, n'ont pas été d'une grande utilité. Ils ne fournirent que spéculations, bien peu de concret, rien de vérifiable.
Tandis qu'au Guatemala, en Autriche et en Espagne, les coaccusés étaient acquittés l'un après l'autre, la justice genevoise a obstinément maintenu les poursuites contre Sperisen. Les charges n'ont cessé de changer. Par moments, Sperisen était censé avoir exécuté des détenus de ses propres mains, à d'autres, il se serait délibérément tenu à l'écart du lieu du crime. Et, plus le procès durait, plus il devenait difficile à la justice genevoise d'admettre qu'elle n'avait pas emprisonné le bon coupable.
Fin septembre 2017, le Tribunal fédéral a mis un terme à cette situation lamentable et ordonné la libération immédiate d'Erwin Sperisen. Depuis lors, il est assigné à résidence, à cent mètres à peine du Palais de Justice de Genève. Les conditions sont chicanières. Trois fois par semaine, Sperisen doit se présenter à un poste de police à l'autre bout de la ville. La justice genevoise n'est pas non plus pressée, le nouveau procès est prévu pour le printemps prochain. Mais au moins Erwin Sperisen est de nouveau auprès de sa famille. Il reçoit Weltwoche dans son petit appartement.
Weltwoche : selon le prononcé du Tribunal fédéral, il ne fait aucun doute que des détenus ont été exécutés lors de l'assaut de la prison El Pavón, il y a onze ans – mais il n'est pas prouvé que vous soyez responsable. Qui a tué les sept détenus?
Erwin Sperisen : Je n'ai pas arrêté de me poser cette question. Ce fut une opération de grande envergure. 2500 membres des forces d'intervention – armée, police, forces spéciales, personnel pénitentiaire – avaient pour mission de reprendre le contrôle de 1800 détenus. J'étais à l’autre extrémité de la prison, à 300 mètres de l'endroit où la fusillade s'est déroulée. Ceci est prouvé par des enregistrements vidéo. Lorsque je suis arrivé, il y avait beaucoup de gens sur place. Je n'ai jusqu'à ce jour aucun doute qu'un échange de tirs entre les détenus et les forces de l'ordre a bien eu lieu. Des enregistrements vidéo attestent que des coups de feu ont été tirés de la prison. J'ai vu les morts à une distance d'une vingtaine de mètres. Mais ce n'était pas mon travail d'enquêter sur ces décès. Le Ministère public était présent depuis le début de l'intervention. Il a tout de suite commencé à relever les empreintes lorsque la situation était sous contrôle. Je me serais rendu passible de poursuites si j'avais interféré dans l'enquête. C'était clairement l'affaire de la justice.
Pourquoi le Ministère public était-il sur place depuis le début?
Nous savions que les détenus étaient armés. Nous nous attendions, en partie à cause d'incidents antérieurs, à ce qu'il y ait des blessés et des morts. Les services sanitaires, également sur place, émettaient, dans le pire des cas, l'hypothèse d'une centaine de morts.
Le soupçon que des exécutions s'étaient produites lors de l'assaut de la prison a cependant rapidement été émis.
Mais ce soupçon ne reposait pas sur les enquêtes menées par le Ministère public. Sergio Morales, le représentant spécial pour les droits de l'homme, l'a fait circuler trois mois après l'événement. Or cette version n'était fondée que sur des déclarations correspondant à des ouï-dire.
Toutefois les blessures et les éléments indiquent qu'il y a eu des exécutions. Il est peu probable que les détenus se soient entretués.
Pourtant, c'est ce que les autopsies permettent de supposer aujourd'hui – pas dans tous les cas, mais au moins dans trois. Mais, à l'époque, je n'étais aucunement informé des enquêtes du Ministère public. Ce n'est que quatre ans plus tard que j'ai eu connaissance des conclusions – à vrai dire émaillées de lacunes. C'est le principal problème de toute cette procédure: il n'y a pas eu d'enquêtes correctes, tout s'est déroulé sous forte pression politique.
Quelqu'un doit avoir ordonné et effectué ces exécutions. Il peut s'agir de la police, de l'armée, des services secrets, des forces spéciales du Ministère de l'Intérieur, du personnel pénitentiaire, des gangs concurrents. Tous étaient armés. Que pensez-vous?
Je n'en sais rien. Je ne peux dire qu'une chose: il n'y a jamais eu de stratégie ordonnée d'en haut, comme l'affirme le procureur de Genève Yves Bertossa. Tous les suspects – notre supérieur hiérarchique, le ministre de l'Intérieur Carlos Vielmann, mon collègue, le directeur du système pénitentiaire Alejandro Giammatei, mes subordonnés, les chefs d'intervention Javier Figueroa et Garcia Frech – ont tous été acquittés. Il y a toutefois une figure centrale dans cette histoire qui n'a jamais été inculpée: Luis Linares Pérez. Le témoin repenti de l'accusation.
Vous pouvez expliquer cela?
Linares Pérez venait du service de renseignement de l'armée, dont, bizarrement, le rôle n'a jamais fait l'objet d'une enquête. Linares Pérez connaissait les préparatifs de l'intervention, il a été impliqué dans la fusillade. Quelques jours avant l'intervention, il y a eu un conflit entre des trafiquants de drogue emprisonnés et d’anciens collègues d’armée de Linares Perez. Linares Pérez est devenu plus tard le principal témoin de l'accusation. Mais ses dépositions - qui, au demeurant, ne m'incriminent même pas directement - sont pleines de contradictions. Il n'a cessé de les modifier et de les adapter aux contradictions. Je suppose qu'il voulait surtout se disculper en dénonçant d'autres personnes. En récompense, il a bénéficié de l'impunité et d'un visa de séjour pour le Canada.
Selon l'acte d'accusation, les «Riveritas», une unité de commando semi-privée sous les ordres directs du ministre de l'Intérieur, ont joué un rôle clé dans la fusillade. Un certain Victor Rivera, un Vénézuélien auquel on attribue un passé à la CIA, dit avoir commandé les troupes. Selon Bertossa, il était l'homme responsable des «actions de nettoyage social».
Ce qui est vrai, c'est que Rivera avait auparavant dirigé une société de sécurité privée qui collaborait étroitement avec la police et le Ministère de l'Intérieur. Il a été engagé par des victimes ou des parents principalement dans des affaires d'enlèvements, de braquages de banque et d'autres formes de criminalité organisée. Cela tenait au fait qu'une société de sécurité privée peut agir avec bien plus de flexibilité et d'agilité que la police qui, comme toutes les institutions de l’État, fonctionne avec beaucoup de lourdeurs et de bureaucratie au Guatemala. Mais Rivera travaillait depuis plusieurs années comme conseiller du ministre de l'Intérieur. Il est vrai que j’ai été surpris de voir M. Rivera et ses hommes sur place à la fin de la reprise de contrôle. Le plan prévoyait que l'armée et la police sécurisent la prison. L'objectif était de démanteler les organisations criminelles qui avaient pris le contrôle de Pavón. Il n'a jamais été question d'actions de nettoyage social.
Est-ce qu'il ne s'agissait pas de vouloir éliminer le crime organisé par un crime d'État?
Si cela avait été le cas, nous aurions procédé différemment. Nous avions présumé que le centre de la résistance serait tout à fait ailleurs, à l'entrée principale. Voilà pourquoi j'étais là-bas. L'assaut du côté sud avait été pensé pour faire diversion. C'est là-bas qu'a eu lieu la fusillade devant le «chalet» du baron colombien de la drogue, Jorge Batres. Batres avait son propre immeuble dans l'enceinte de la prison, il avait ses gardes du corps, des caméras, du personnel de maison et tout ce qui va avec.
Avant l'intervention dans la prison, il y avait eu des menaces de la mafia contre le directeur du système pénitentiaire, Alejandro Giammatei: soit l'opération était annulée, soit toute ta famille serait tuée. Si l'on peut compter sur quelque chose au Guatemala, c'est bien sur la vengeance de la mafia. Il serait logique, peut-être même compréhensible, que les responsables se soient dit dans cette situation: «liquidons les chefs de la mafia avant qu'ils ne nous liquident».
Oui, c’est une hypothèse qui a été effectivement soulevée contre M. Giammattei. J'ai beaucoup réfléchi à cette possibilité, j'en avais tout le loisir. Mais je ne crois pas que les choses se soient passées comme cela. Et, si cela avait été le cas, cela aurait été l'affaire des autorités d'exécution des peines, pas la mienne. Je n'y aurais rien gagné, et je n’ai reçu ni eu connaissance d’aucune menace des détenus de Pavón.
Vos adversaires politiques vous accusent d'avoir systématiquement pratiqué des «opérations de nettoyage social». Ce soupçon est de nouveau dans l'air depuis les combats de la guérilla. On enregistre chaque année au Guatemala près de 6000 meurtres, la plupart d'entre eux ne sont jamais élucidés, le système judiciaire faillit lamentablement. Vouliez-vous lutter contre le crime par le crime?
Depuis la Conquista, ces atrocités ont été récurrentes au Guatemala, à vrai dire auparavant aussi. Je me suis présenté pour lutter contre la violence. Ma politisation remonte aux années 90. C'était l'époque des négociations de paix. J'appartiens à une génération qui s'est engagée avec l'espoir et la volonté de vaincre la terreur et de faire du Guatemala une nation moderne, civilisée. Mes plus grosses difficultés se situaient au sein de la police même parce que je n'accepte ni la corruption ni le lynchage.
Dans certains médias, on a fait de vous un fanatique évangélique qui prêche la guerre sainte contre le crime. Comment vous positionnez-vous à ce propos?
C'est n'importe quoi! C'est un journaliste du Salvador qui a fait courir cette théorie, reprise ensuite par d'autres. Cela n'a aucun sens, c'est contraire à mes principes. Je suis protestant. Mais je n'ai jamais prêché ma foi et je n'ai, à plus forte raison, jamais été un fanatique. Ce qui est vrai, c'est que j'ai eu une fois, comme chef de la police, une émission de télévision sur une chaîne évangélique. J'avais alors l'ambition de faire une carrière politique. Mais la religion n'a jamais été abordée dans mon émission qui a toujours tourné autour de la sécurité et du travail de la police. La chaîne est venue me chercher non pas parce que je suis protestant, mais plutôt parce que la société d'exploitation voulait diffuser quelque chose qui n'avait rien à voir avec la religion et qui intéressait le public. J'avais une audience de six millions de téléspectateurs, dont de nombreux policiers que je touchais de cette façon. C'était une émission dans laquelle nous insérions de nombreux appels en direct de téléspectateurs qui se plaignaient des problèmes de sécurité, mais aussi des abus commis par la police.
La question de la religion a aussi pesé sur le procès de Genève comme une accusation implicite. Les évangélistes ont la réputation d'être des «hardliners» de droite.
Il y a des raisons historiques à cela. Avec ce qu'on a appelé la théologie de la libération, une alliance a vu le jour entre les guérillas et des parties de l’Église catholique, en particulier des jésuites, dans toute l'Amérique centrale. Aujourd'hui, près de la moitié de la population du Guatemala est protestante. Cela provoque des tensions qui sont totalement caricaturées en Europe. Dans toute l'Amérique du Nord comme du Sud, la liberté religieuse a toujours eu un sens différent de celui qu'elle a en Europe. Chez nous, la religion est considérée comme une affaire privée, je partage cette opinion. En Europe, il s'est toujours agi de protéger l’État contre l'influence des Églises – en Amérique, la priorité était inverse: il fallait protéger les Églises de l'influence de l’État.
Où vous situez-vous politiquement?
Je suis en général conservateur, centre-droit. Les extrêmes me sont étrangers. Je pense que les choses doivent se développer progressivement et de l'intérieur. Oui, je crois en les valeurs chrétiennes traditionnelles. Il ne faut pas jeter par-dessus bord d'un jour à l’autre ce que la tradition nous a livré. En matière économique, je suis plutôt un tenant de Hayek que de Keynes. Je crois qu'un petit État doit être au service de sa population, et non l'inverse.
La gauche genevoise vous décrit comme un oligarque. Qu'en pensez-vous?
Mes grands-parents avaient une petite vitrerie au Guatemala. Ils ont tout perdu dans les années 60 quand mon grand-père est tombé malade. Mon père a monté tout seul une menuiserie qui s'est transformée au fil du temps en une petite usine de meubles. Il est venu à la politique par le biais de l'association des petits entrepreneurs, puis à son mandat à Genève où il représente le Guatemala à l'OMC. J'ai grandi dans la classe moyenne.
Qu'en est-il de votre relation à la Suisse?
À la différence de mon père, je n'ai appris aucune des langues nationales. Je suis pourtant venu en Suisse à l'âge de vingt ans pour effectuer l'école de recrues, comme mon père l'avait fait en son temps. Mais on n'a pas voulu de moi; d'une part, à cause de mon manque de connaissance des langues, d'autre part, mon enthousiasme pour l'armée a suscité la méfiance. Je sais que l'on peut retourner cela maintenant contre moi. Mais je ne suis pas un Rambo. Dans l'armée suisse, ils ne veulent que des soldats qui n’ont pas vraiment envie de faire de service (il rit).
Votre formation?
J'ai étudié la gestion d'entreprise au Guatemala et fait un stage pratique dans un hôtel. Mon patron s'est engagé en politique. Il a suscité mon enthousiasme pour la politique et m'a fait venir à la municipalité de Guatemala. J'y ai travaillé comme assistant du maire. Plus tard, j'ai fait un stage au Ministère public. J'ai fait une licence en sciences politiques en tant qu'étudiant salarié. J'ai rencontré ma femme Elisabeth à l'université. Elle est originaire du Salvador, mais a aussi des racines suisses.
Comment êtes-vous devenu chef politique de la «Policía Nacional Civil» du Guatemala?
Adolescent, je me suis engagé comme pompier volontaire et dans la protection civile. Je sais que cela fait kitsch, surtout dans mon rôle d'auteur supposé d’un massacre. Mais c'est ainsi. J'ai toujours eu la vocation pour le bien commun. En 2004, on m'a proposé de prendre le commandement des pompiers de tout le Guatemala. J'étais déjà en pleines négociations salariales lorsque le ministre de l'Intérieur, Carlos Vielmann, m'a proposé, à ma grande surprise, la fonction de chef de la police. Il m'a donné dix heures pour réfléchir. J'avais l'impression de ne pas avoir la carrure pour ce poste. Je n'appartenais pas au parti au pouvoir. J'avais 34 ans, aucune expérience avec la police nationale, mais seulement avec la police municipale. Mes amis et ma famille m'ont supplié à genoux de refuser cette proposition. La police a très mauvaise réputation au Guatemala, elle est considérée comme un cimetière politique. Chez les pompiers, il y a peu de risques de commettre des erreurs. Mais je me suis finalement dit, on ne peut pas toujours critiquer la police, puis se cacher quand on a la possibilité de faire quelque chose. J'ai donc accepté le lendemain matin.
Combien gagniez-vous en tant que chef de la police?
Autour de 2800 dollars par mois. Ma femme gagnait plus en tant que consultante en planification et en affaires (il rit). Mon salaire ne nous aurait pas permis de payer l'école pour les trois enfants ni l'hypothèque de notre appartement. Après mon départ de la police, j'ai publié mes finances – j'avais moins d'argent qu'avant mon entrée en fonction.
Quelles étaient les principales préoccupations du chef de la police?
Il manquait de tout, des uniformes convenables jusqu'aux toilettes dans les postes de garde. Dans les grandes lignes, il y avait trois questions: le personnel, l'équipement, la communication. Dans le cadre d'un premier état des lieux, nous avons défini plus de 500 projets, dont j'ai pu lancer environ la moitié et achever certains d'entre eux en trois ans, c'est-à-dire pendant mon mandat. En plus de l'infrastructure, la corruption était le problème majeur. Nous avons mis en place des assurances-vie pour les veuves de policiers assassinés, des garderies, des services médicaux pour les proches parents, construit des lotissements sécurisés, amélioré la formation et les possibilités de carrière. Nous avons été les premières forces de police dans toute l'Amérique à équiper tous les véhicules d'un système de localisation par GPS et certains, de caméras. L'objectif était de créer un lien renforcé entre les policiers et l'institution, de les protéger, mais aussi de les contrôler. Ce sont les moyens les plus efficaces contre la corruption. Un officier de police qui a beaucoup à perdre y réfléchit à deux fois avant de se laisser soudoyer. La coordination internationale a suivi. J'étais très actif en tant que président de l'Organisation des chefs de police d'Amérique centrale et des Caraïbes ainsi qu'auprès d'Interpol.
Au cours de votre mandat, la commission d'enquête internationale CICIG* a été constituée. C'est elle qui engagera plus tard des poursuites à votre encontre. Quel était l'objectif?
Initialement, il s'agissait de créer une autorité qui enquêterait pour faire la lumière sur des structures parallèles mafieuses au sein des organismes d'État et pour les combattre. Il y avait partout de tels syndicats qui pratiquaient la corruption dans les communes, à la douane, dans l'armée. On parlait aussi d'«opérations de nettoyage social». Nous voulions mettre sur pied une organisation internationale parce que nous ne pouvions pas faire confiance à notre propre personnel. J'ai entièrement soutenu son action. Mais lorsqu'en 2008, le nouveau gouvernement est arrivé au pouvoir, la CICIG a changé d'orientation.
Pourquoi?
De toute évidence, la CICIG n'arrivait pas à avancer dans la lutte contre la mafia au sein des structures de l’État. Il fallait présenter des résultats, on s'est alors emparé de ce qui semblait plus facile. Le nouveau gouvernement d'Alvaro Colom mandata, par conséquent, la CICIG pour enquêter sur les événements d'El Pavón qui étaient devenus une affaire politique. Les poursuites détournaient aussi les regards d'un scandale de corruption et d'assassinat – l'affaire Rodrigo Rosenberg – qui avait engendré une véritable crise au sein du gouvernement Colom. L'opération d'El Pavón était jusqu'à cette époque considérée comme un succès du gouvernement précédent d'Oscar Berger. Les poursuites de la CICIG visaient à démonter cette image positive. Après ma démission, j'avais une cote de popularité très élevée dans les sondages d'opinion, le directeur du système pénitentiaire Alejandro Giammatei passait même pour être un candidat potentiel pour le prochain gouvernement.
Pourquoi avez-vous démissionné en 2006 et déménagé à Genève?
Il y avait eu plusieurs tentatives d'assassinat à mon encontre. Mon hélicoptère a été saboté, des grenades ont dévasté mon bureau, on avait tiré une fois sur moi et une fois sur ma voiture. Il y avait aussi des menaces concrètes contre ma femme et mes enfants. J'ai d'abord envoyé ma famille aux États-Unis, mais les autorités américaines avec lesquelles j'avais un très bon contact ne pouvaient nous donner aucune garantie. La mafia de la drogue est également active aux États-Unis. Voilà pourquoi j'ai envoyé ma famille à Genève, où mon père travaille à l'OMC.
Que comptiez-vous faire ensuite?
Nous envisagions un séjour d'un an seulement jusqu'à ce que la situation se calme au Guatemala. Mais ma femme a trouvé un emploi au sein de la mission du Guatemala auprès de l'ONU, les enfants se sont acclimatés. C'est alors que s'est produit le scandale de l'assassinat de trois parlementaires par des policiers. Une histoire compliquée dans laquelle l'argent de la drogue jouait un rôle. Les appareils GPS que j'avais fait installer dans les véhicules de police ont notamment permis de confondre les policiers. Je décidai néanmoins de démissionner en même temps que le ministre de l'Intérieur. J'ai longtemps hésité. Ce fut une décision purement politique, aucune faute ne m'a jamais été imputée. C'est comme cela que je suis venu retrouver ma famille en Suisse.
Pourquoi y avait-il eu des attentats contre vous et votre famille?
Je ne suis jamais tombé sous la coupe d'aucune bande mafieuse.
Qu'entendez-vous par là?
Les offres viennent toujours par l'intermédiaire de tiers, d'informateurs de second ordre, jamais directement des chefs. Cela commence de manière anodine. Un gang de la mafia fait passer des informations sur un gang rival à la police, se montre coopératif. Il y a des arrestations, du prestige. Cela crée une proximité qui devient rapidement dangereuse. Pour le policier qui fait face tous les jours à des problèmes d'argent, la tentation est grande de détourner un peu d'argent pour lui ou pour l'institution. Mais cela rend la police vulnérable au chantage. Les organismes internationaux tels que la DEA fonctionnent sur cette base. Ils s'allient à un gang pour combattre l'autre. J'ai mis un terme à cette pratique au Guatemala. Nous n'avons par principe plus collaboré avec aucun gang. Il y a eu certes moins d'arrestations spectaculaires, mais plus aucun gang ne pouvait compter désormais sur la protection de la police. C'est là qu'ont commencé les menaces de mort et les attentats, associés à des offres transmises par des hommes de paille de second plan. Un grand classique: «plomo o plata» – vous avez le choix entre l'argent ou le plomb.
Avez-vous fui le Guatemala?
Non. Le gouvernement du Guatemala a payé les billets d'avion, dans un premier temps pour ma famille, puis pour moi. Parce que le gouvernement n'était plus en mesure de garantir notre sécurité. Les accusations portées contre moi ont fait surface beaucoup plus tard.
Quels étaient vos projets en Suisse?
J'avais la perspective d'un emploi à Interpol à Lyon. Ce n'est pas loin de Genève et aurait été parfait. En tant que chef de la police, j'avais encouragé les relations avec Interpol et les avais modernisées, j'avais une très bonne réputation à Lyon, ils me connaissaient aussi du fait de mon engagement dans les associations internationales. La langue n'était pas un problème grâce à mes connaissances de l'anglais. Il n'y avait pas d'offre concrète, mais Interpol avait signalé un intérêt de principe. J'avais aussi eu des entretiens avec des institutions suisses. Lorsque les accusations de la CICIG à mon encontre sont apparues, il n'en était bien sûr plus question.
Comment avez-vous appris ces accusations?
C'était en septembre 2010. Je regardais sur Internet le journal du matin du Guatemala. La CICIG y annonçait qu'elle avait ouvert une enquête contre dix-neuf fonctionnaires du gouvernement d'Oscar Berger parmi lesquels figurait mon nom. Ils nous accusaient de dix-sept délits allant du trafic de drogue au meurtre en passant par le harcèlement sexuel, le vol de voitures et les enlèvements – tout un florilège. J'étais choqué. J'ai informé Maître Florian Baier, un ami de la famille. Baier a immédiatement écrit une lettre au procureur général de Genève de l'époque, Daniel Zappelli. J'ai expliqué où je vivais, que j'étais à tout moment à la disposition des autorités et je l'assurais de ma coopération sans réserve. Deux semaines plus tard, ma femme a été licenciée de la mission du Guatemala auprès de l'ONU, sans motif.
Que s'est-il passé ensuite?
Pendant un an, il ne s'est absolument rien passé. En 2011, le procureur Michel-Alexandre Graber m'a convoqué dans son bureau. Il m'a montré un rapport de la CICIG qui lui avait été envoyé du Guatemala. Dans le cadre de l'interrogatoire, il s'est avéré que rien de concret n'était retenu contre moi. Graber a annoncé une requête d'entraide judiciaire adressée au Guatemala qui comportait la demande d'exposer ce qui était retenu contre moi. J'étais d'accord, je voulais que cette affaire soit clarifiée. J'ai spontanément donné mon accord pour la divulgation de l'ensemble de ma situation financière. Un an plus tard, j'appris qu'un nouveau procureur, Yves Bertossa, s'occupait désormais de mon affaire. Cela m'a inquiété parce que Bertossa est étroitement lié à l'ONG TRIAL, comme je l'ai découvert dans une recherche sur Google. Des groupes de gauche en étroite relation avec TRIAL créaient depuis un certain temps un climat hostile à mon encontre, mais sur un sujet complètement différent. TRIAL avait même engagé un détective qui espionnait ma vie privée.
Il y avait donc des accusations antérieures contre vous?
Cela n'avait rien à voir directement avec la procédure officielle. Il s'agissait de l'affaire «Finca Nueva Linda», une occupation illégale de terres, un conflit armé entre des organisations « paysannes », soit d'ex-guérilleros en 2004 à Retalhuleu. Cela s'était produit quelques semaines après ma nomination en tant que chef de la police. Sur l'ordre de la Cour suprême, la police a dû intervenir à l'époque, il y a eu des morts et des blessés des deux côtés. Les ONG de gauche de Genève avec les syndicats et le Parti Vert ont voulu en faire une affaire politique. Des plaintes ont été portées contre moi et même contre mon père, ce qui était tout à fait absurde. Un drôle de mélange. Une grande enquête menée au Guatemala a montré que la police avait agi correctement. La CICIG n'en a plus parlé.
Rigoberta Menchu, Prix Nobel de la paix, s'est également engagée dans l'affaire «Finca Nueva Linda». La connaissez-vous?
Bien sûr, elle a travaillé pour le gouvernement Berger comme ambassadrice culturelle. Je suis même allé chez elle. Dans le contact personnel, elle est plutôt réservée, mal assurée, tout le contraire de ses apparitions sur la scène internationale. Mais, au Guatemala, on connaît aussi le chemin qu'elle a parcouru avec la guérilla. Il diffère un peu de celui qui figure dans sa biographie officielle. Menchu s'est ensuite détournée de Berger et a changé de camp politique.
Le 31 août 2012, Bertossa vous a fait arrêter. Comment avez-vous vécu cela?
J'étais avec ma femme sur un parking à Genève, nous venions tout juste de faire les courses. Tout à coup, nous avons été encerclés par douze hommes lourdement armés qui ont pointé leurs armes sur nous. Nous avons cru à une agression. J'ai été soulagé quand j'ai compris que c'était la police. L'opération était du théâtre, de l'intox. Bertossa aurait aussi pu m'envoyer une convocation. Il savait où j'habitais.
Le procureur Bertossa croyait juste détenir la preuve que vous êtes l'auteur d'un massacre – le témoin Philippe Biret s'était présenté à lui. Le Français, qui purgeait alors une peine de trente-cinq ans de prison à El Pavón pour un double meurtre, affirmait vous avoir vu de ses propres yeux abattre des prisonniers lors de l'intervention dans la prison.
L'organisation TRIAL avait fait intervenir ce témoin. Ce qu'il racontait était facile à réfuter. J'ai été pratiquement filmé pendant toute la durée de l'intervention, tout est enregistré sur vidéo. Je n'ai eu pendant tout ce temps qu'un seul contact avec un détenu – et c'est celui qui a remercié les autorités d'être enfin intervenues. La prison était à l'époque entièrement sous le contrôle des mafias. Meurtres impunis et autres crimes étaient monnaie courante. Biret prétend que j'aurais tiré une balle dans la tête de l'une des victimes – mais il ne figure aucune blessure à la tête dans les autopsies. Toutes les blessures provenaient de balles de 5,56 – des balles de fusils qui ne s'emploient pas dans une arme de poing. Biret a également affirmé que les meurtres ont été perpétrés dans l'après-midi – mais les sept détenus étaient morts le matin. L'endroit où j'étais supposé avoir tiré ne correspondait à aucun enregistrement vidéo. À chaque audition, Biret s'enfonçait plus profondément dans ses contradictions. Au tribunal, on a voulu faire passer ces contradictions pour des séquelles d'un traumatisme. Un cercle vicieux classique. On n'a même pas envisagé qu'il ait pu mentir.
Entre-temps , les accusations de Biret ne sont plus un problème, la Cour d'appel les a rejetées. Pourquoi Biret vous a-t-il faussement accusé?
Je ne connais pas cet homme. Mais j'ai appris par des tiers que Philippe Biret avait acheté sa libération anticipée en déposant contre moi au Guatemala. C'est comme cela que s'est déroulée cette procédure du début à la fin. Des gens ont été récompensés ou mis sous pression pour dire ce que l'on voulait entendre d'eux. Par chance, tout a été si mal mis en scène que les dépositions étaient pleines de contradictions. Sauf que je ne pouvais rien faire de ma cellule de prison à Genève pour y parer. Si j'avais tenté de procéder personnellement à des enquêtes, on m'aurait accusé de collusion. D'autre part, la CICIG a empêché les personnes qui m'auraient disculpé, comme mon garde du corps, de se rendre à Genève pour faire une déposition.
Apparemment, le procureur Yves Bertossa n'a bientôt plus cru lui-même son propre témoin à charge, Biret. Début 2013, il a fait une proposition à vos avocats: si vous avouiez un délit mineur quel qu'il soit et que vous accusiez d'autres personnes, il vous laisserait vous en tirer dans le cadre d'une procédure accélérée secrète avec cinq ans de prison dont un tiers de remise de peine. Pourquoi n'avez-vous pas accepté?
Parce que je n'avoue pas de crimes que je n'ai pas commis. Et parce que je n'accuse pas à tort d'autres personnes.
Les poursuites engagées au Guatemala par la CICIG contre les chefs politiques et les chefs de la police et du système pénitentiaire ont toutes conduit ultérieurement à des acquittements – sauf dans votre cas. Quel était le motif de ces accusations apparemment sans fondement?
Cela a commencé avec l'assassinat du conseiller à la sécurité, Victor Rivera, en avril 2008. L'enquêtrice de la CICIG, Gisela Rivera, une juriste du Costa Rica, n'a pas pu résoudre cette affaire. Sur les ordres du nouveau gouvernement Colom, elle a transféré l'enquête sur l'affaire d'El Pavón. On exerçait une forte pression sur Gisela Rivera pour obtenir des résultats. Cela s'est vu un an plus tard lorsque Gisela Rivera a précipitamment quitté le Guatemala. Parce qu'elle avait fait pression sur des témoins et conclu des accords secrets, elle faisait alors elle-même l'objet de poursuites et un mandat d'arrêt international a été lancé à son encontre. Le procès parallèle de mon adjoint, Javier Figueroa, en Autriche a révélé comment Rivera avait procédé avec les dépositions extorquées. Figueroa avait secrètement enregistré la conversation avec Rivera. Malheureusement, les successeurs de Gisela Rivera n'étaient pas mieux et ont continué dans le même style. La confusion était totale. Au final, les enquêteurs se sont mutuellement dénoncés, personne ne savait plus qui roulait pour qui. Les politiques étaient depuis toujours mouillés dans cette affaire – Les Verts de Genève, les Verts en Autriche, les socialistes au Guatemala et, au beau milieu, les ONG. On n'a jamais pu parler d'enquête sérieuse.
Bertossa le savait?
Bien sûr. Il faisait partie de ce théâtre. Bertossa est lié à TRIAL, le procureur de la CICIG, Carlos Castresana, était parlementaire de la gauche unie («Izquierda Unida») en Espagne, la cour de justice à Genève était essentiellement composée de juges membres de partis de gauche. Les réseaux internationaux des ONG de gauche, de leurs juristes et de leurs politiciens sont incroyablement efficaces. En Autriche, la présidente du tribunal a protesté avec véhémence contre l'ingérence politique. Cela n'a malheureusement pas été le cas à Genève. Ce fut un procès politique du début jusqu'à la fin.
Comment avez-vous vécu les procès à Genève?
J'ai vite compris que je n'avais aucune chance. On le remarquait à l'attitude des procureurs et des juges. Ils m'ont donné à comprendre par des gestes et des remarques désobligeantes que mes déclarations ne les intéressaient pas, qu'ils ne croyaient de toute façon pas un mot de ce que je disais, que l'issue du procès était claire depuis longtemps et qu'ils ne cherchaient que des éléments pour fonder d'une manière ou d'une autre leur verdict.
C'est une accusation grave. Pouvez-vous le prouver?
Il est difficile de prouver ce genre de choses. Je vais vous donner un petit exemple. Pour exposer mon rôle, la juge a pris comme référence le rôle du directeur de la police de Genève. Voulant démontrer l'absurdité de cette comparaison, j'ai essayé de mettre en évidence les différences d'échelles: 6000 meurtres par an, pour la plupart non élucidés, au Guatemala contre 6 à 8 homicides généralement élucidés à Genève, 24 000 policiers contre 3000, 110 000 kilomètres carrés avec 15 millions d'habitants contre 16 kilomètres carrés avec une population de 300 000 personnes – et ainsi de suite. Je voulais montrer comment il est difficile de juger de la réalité du Guatemala à partir de Genève. Plus tard, j'ai eu l'occasion de constater que mes déclarations concernant Genève n'avaient tout bonnement pas été enregistrées. Ma déclaration a pris un tout autre sens. Pour l'administration des preuves, cela peut sembler anecdotique à la fin. Mais ce fut un procès basé sur des présomptions, sans aucune preuve. Et, tout d'un coup, ce genre de choses prend de l'importance. Il y eu d'innombrables irrégularités comme celle-ci.
Au cours du premier procès de Genève, vous avez été condamné pour participation active au massacre, au cours du second, en raison de votre comportement passif. Comment expliquez-vous ce retournement de situation?
C'est un schéma que l'on retrouve tout au long de la procédure. La défense a réfuté une accusation après l'autre – parce que les déclarations étaient contradictoires, parce qu'elles ne correspondaient pas aux faits. Mais, après chaque version qui s'écroulait, il en surgissait une nouvelle; les accusations ont été constamment modifié. C'était comme un interminable cauchemar. Sauf que le cauchemar était réel. À la fin, on a tout simplement co-condamné les présumés co-conspirateurs qui avaient été depuis longtemps acquittés à l'étranger – sans accusation formelle ni possibilité de se défendre. Il n'y a rien à ajouter à cela!
Pour quel motif précis avez-vous été condamné?
Bertossa ne le sait pas, le tribunal ne le sait pas, je ne le sais pas, personne ne le sait. C'est ce qu'il y a de fou dans ce procès. On a dit que mon adjoint – Javier Figueroa acquitté en Autriche – était proche de la scène du crime et que, par conséquent, je devais avoir quelque chose à voir avec les morts; et, parce que j'étais le chef de Figueroa, je dois avoir quelque chose à voir avec cela. Comment voulez-vous vous défendre face à une accusation si confuse? C'est impossible.
Comment se sent-on au cours d'un tel procès?
Impuissant, tout bonnement impuissant. On m'a clairement fait sentir dès le début: ici, tu es seul – tu es une caricature du chef de la police d'une république bananière que personne ne croit – contre les procureurs, les gouvernements, l'ONG, l'ONU, le monde. On ne sait pas alors si l'on doit encore déclarer quelque chose ou s'il vaut mieux se taire. Chaque mot prononcé est déformé et retourné contre vous. Bertossa ne s'est même pas donné la peine de feindre l'impartialité – il a ostensiblement traité avec mépris les témoins à décharge qui étaient venus du Guatemala; tandis que les témoins de l'accusation séjournaient dans le même hôtel que les enquêteurs de la CICIG, qui intervenaient lorsque les témoins ne déclaraient pas ce que l'on attendait d'eux. Il y avait de quoi devenir fou.
À votre avis, que se passait-il dans la tête de Bertossa?
Je pense qu'il ne m'a pas perçu comme un être humain, mais comme une figure abstraite. Un échelon dans sa carrière.
Mais pourquoi? La plupart des Genevois savent à peine où se trouve le Guatemala. Pourquoi votre condamnation était-elle si importante pour un procureur à Genève?
À Genève, on aimerait mettre en place quelque chose comme un Ministère public mondial des droits de l'homme. La CICIG au Guatemala était un projet pilote pour la poursuite pénale mondiale dans ce qu'on appelle les «États faillis». Il y a à Genève des ONG très influentes et actives comme TRIAL. Il y a dans la machine onusienne le Conseil des droits de l'homme et le Haut-Commissaire aux droits de l'homme. J'étais l'objet, l'exemple sur lequel on voulait s'exercer à la poursuite pénale mondiale. Lorsque l'on s'est aperçu que cela ne marchait pas, on a commencé à magouiller.
Vous avez passé cinq ans en détention provisoire au nom des droits de l'homme – isolé dans une cellule individuelle. Qu'est-ce que cela signifie concrètement?
On ordonne un isolement carcéral aussi long pour briser une personne – moralement, physiquement, mentalement. On est enfermé 23 heures sur 24 dans une cellule de 2,35 mètres de large sur 4,5 mètres de long, un WC, un lit rudimentaire. On compte les jours (Sperisen a sorti un calepin), on fait une croix pour chaque jour – 1849 jours, 272 semaines, 60 mois. Lorsque les gardiens ne m'oubliaient pas, j'avais 15 minutes par jour pour me doucher. Une fois par jour se dégourdir les jambes, seul, pendant une heure dans une cage sur le toit, l'une de 5 mètres sur 6, l'autre de 9 mètres sur 18. Une fois, parfois deux fois par semaine, une heure de visite de la famille. Ma femme est venue 423 fois, parfois avec les enfants. Mes avocats Florian Baier et Giorgio Campa sont venus respectivement 198 fois et 63 fois. J'ai vu mes enfants pendant ces cinq ans, en tout et pour tout, une bonne semaine, toujours sous surveillance. J'ai tout scrupuleusement noté. On n'a de toute façon rien d'autre à faire. À part lire. J'ai lu des centaines de livres, de Shakespeare à Garcia Márquez, une fois le Coran et deux fois la Bible. À 7 heures du matin, les gardiens jettent brièvement un œil à l'intérieur pour voir si on est encore en vie, ils disent quelques phrases pour voir si l'on a encore toute sa tête. À 7 heures, 11 heures et 17 heures, ils glissent le plateau-repas, à 18 heures 15, le personnel prend congé.
Aviez-vous peur de devenir fou?
Tout le temps. On doit toujours faire quelque chose. Il faut beaucoup de discipline pour ne pas devenir fou. En moyenne, j'avais trois heures de contact direct avec des êtres humains par semaine.
Est-ce que cela ne fabrique pas de la haine – envers le procureur Bertossa, les juges?
Oui. De la haine et du mépris. J'ai bien sûr souhaité que Bertossa et la juge passent autant d'heures que moi en cellule. Pour qu'ils sentent ce que c'est. Mais j'ai délibérément mis un verrou à ces sentiments. La haine, c'est à moi qu'elle aurait fait le plus de mal. Elle leur était égal. Les détester signifierait lier ma vie à eux. Je ne le veux pas. Je ne les laisse pas gouverner ma vie.
Qu'est-ce qui est pire – cinq ans dans une prison guatémaltèque comme El Pavón où les détenus se déplacent librement ou cinq ans en isolement dans une prison suisse?
Cela dépend. Un chef de gang a tout ce que vous pouvez vous imaginer à El Pavón. Mais celui qui n'a pas d'argent vit comme un esclave, dépourvu de toute dignité humaine, sans protection ni loi. C'était la situation à laquelle nous voulions mettre un terme avec l'intervention. En Suisse, c'est l'autre extrême. Tout est réglementé et hyper-contrôlé – ce qui conduit aussi à la déshumanisation. J'ai dit une fois à Bertossa: «Nous sommes intervenus une fois à El Pavón avec les fouilles, et uniquement sous la protection de la police, parce que certains prisonniers étaient armés – ici, à Champ Dollon, j'ai dû me déshabiller entièrement et me laisser fouiller après chaque visite de ma famille, alors qu'un gardien était toujours présent durant la visite».
Votre personnalité a-t-elle changé au cours de ces cinq années?
Je suis certainement devenu plus réfléchi. Lorsque nous avons dû quitter le Guatemala, j'ai eu le sentiment que nous avions tout perdu: la maison, la voiture, le travail. Après mon arrestation, je me suis rendu compte que tout cela n'était rien, qu'on pouvait tomber beaucoup plus bas. Aujourd'hui, ma famille vit de l'aide sociale, à cinq dans un appartement d'une pièce. Je n'ai pas d'argent pour payer les deux avocats, l’État n'en paie qu'un, et seulement à 50%. Je dépends de leur bonne volonté. Il a fallu deux avocats rien qu'à cause des langues. De l'autre côté, Bertossa avait à son service toute une équipe d'assistants qui n'arrêtaient pas de produire des pièces. Le pire, c'est d'avoir manqué les plus importantes années de l'évolution de mes enfants. Aucun argent au monde ne pourra le compenser. J'ai certes vu les enfants toutes les semaines, mais dans une situation qui n'avait rien de naturel, comme dans un laboratoire. On se donne mutuellement du courage, chacun a joué son rôle, préoccupé que l'autre ne se fasse pas de souci. On ne peut plus parler de véritable relation.
Comment vous êtes-vous senti en sortant de votre cellule au bout de cinq ans?
Ce fut un choc. Je me suis senti comme un handicapé auquel on a retiré les béquilles, comme un émigrant qui revient au pays après une longue période – on connaît tout, et pourtant tout est étranger. Il m'est arrivé de me lever la nuit, d'aller voir les enfants qui dormaient pour m'assurer qu'ils étaient toujours là. Ma femme m'a conduit comme un petit enfant dans la ville quand j'avais quelque chose à faire.
En 1954, le président Jacobo Arbenz, fils d'émigrants suisses d’Andelfingen, a été renversé au Guatemala. Le gouvernement suisse d'alors, de tendance bourgeois, lui a refusé asile et protection sous prétexte qu'il était communiste, ce qui était une bêtise. Soixante ans plus tard, le canton de Genève très à gauche emprisonne le Suisse de deuxième génération Erwin Sperisen, originaire de Niederwil, parce qu'il est supposé être un extrémiste de droite. Pourquoi la Suisse traite-t-elle aussi mal ses propres ressortissants?
Je n'en sais rien. La Suisse reste un pays très ordonné, à maints égards un pays modèle. On veut tout faire parfaitement, on est plus sévère avec ses propres citoyens qu'avec des étrangers. Ce qui m'est arrivé ici aurait également pu se produire ailleurs. Mais c'était humiliant. Genève a voulu retirer à ma femme le permis de séjour au bout de dix ans, sous prétexte qu'elle ne pouvait pas vivre avec son mari, étant donné que j'étais en prison – et pourtant, ma femme a aussi des ancêtres suisses, et elle a saisi chaque opportunité de me rendre visite, et nos enfants sont suisses! Mon père a dû renoncer à la citoyenneté suisse parce que le DFAE voulait lui retirer son accréditation de diplomate auprès de l'ONU après mon arrestation – argumentant qu'il ne pouvait travailler comme diplomate en Suisse étant Suisse! Le Secrétariat d’État aux migrations a mandaté une expertise juridique visant à me retirer la citoyenneté suisse. Ce n'était légalement pas possible. Mais ce genre de choses donne quand même à réfléchir. Et elles font mal.
Encore une fois – pourquoi la Suisse traite-t-elle si mal ses propres citoyens?
Mon grand-père a quitté la Suisse parce qu'il voulait plus que ce que ce pays pouvait lui offrir. Peut-être lui en a-t-on voulu pour cette raison. J'ai senti pour la première fois ce rejet quand je me suis présenté pour faire l'école de recrues en Suisse. En Suisse, on n'aime pas que quelqu'un vise trop haut, qu'une personne fasse preuve de trop d'initiative. C'est comme si le troupeau rejetait le mouton qui a osé quitter le troupeau. J'ai déjà entendu cela dans la bouche d'autres Suisses de l'étranger.
Comment se présente votre avenir?
D'abord, je dois terminer le procès. Je dois rétablir mon honneur. C'est la seule chose que je puisse encore laisser à mes enfants. Si je n'ai pas pu leur donner autre chose, ils ne doivent au moins pas souffrir de la stigmatisation d'avoir un père injustement condamné.
Au Guatemala, votre réputation ne semble guère abîmée. Sur Facebook, vous avez 30 000 followers, les commentaires vous sont tous favorables.
32 000 followers! C'est mon frère qui a créé la page, je n'étais pas vraiment au courant et j’ai été agréablement surpris de ce soutien. Un demi-million d'utilisateurs a vu mon message vidéo posté par mon frère après ma libération.
Allez-vous retourner au Guatemala quand tout cela sera fini?
Je n'en sais rien. Je me sens Guatémaltèque. Mais ma famille est installée à Genève, il est peu probable que mes enfants veuillent déménager.
* La CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala) est une autorité internationale sous l'égide de l'ONU chargée de poursuites pénales, mise en place en 2007 sous le gouvernement d'Oscar Berger. En 2019 la CICIG, qui menait les investigations du cas Sperisen, était dissolue et expulsé de Guatemala pour corruption et abus de pouvoir.
5. Personne n’est responsable
3. Mai 2018 – La chambre pénale d’appel de Genève a développé une 3e version des faits lui permettant de condamner Erwin Sperisen. Faute de preuves, la peine est réduite, et l’ancien chef de la police reste en liberté. Le Tribunal fédéral devra désormais trancher.
Il est parfois vraiment dommage que les caméras ne puissent pénétrer au sein des salles d’audience. Les mines renfermées des 6 juges de la Chambre pénale d’appel et de révision à Genève qui subissaient patiemment l‘ouverture du verdict de la présidente Alessandra Cambi Favre-Bulle auraient constitué une fresque monumentale pour les livres d’histoire. L’horreur se reflétait sur leur visage.
Les six juges n’étaient pas à envier, eux qui disposaient de la vie d’autrui, au-delà du seul accusé. En déclarant Erwin Sperisen coupable, ils ruinaient l’existence d’un homme potentiellement innocent ainsi que de toute sa famille, assis sur les bancs derrière l’accusé. Car les preuves solides prouvant la culpabilité de l’ancien chef de la police du Guatemala n’existent pas. En le déclarant non coupable, ils désavouaient une douzaine de juges et de fonctionnaires de la justice genevoise, qui condamnaient préalablement Erwin Sperisen à vie sur ces bases peu tangibles. Les oreilles en pointe, témoins muets des événements, ceux-ci écoutaient maintenant l’annonce du verdict depuis la galerie.
Pour Yves Bertossa, procureur général, un acquittement aurait constitué une défaite existentielle, lui qui avait fait arrêter Sperisen en août 2012, se mettant sous pression avec une obligation de résultat. Même contexte pour la présidente Alessandra Cambi Favre-Bulle, qui refusa de relaxer l’accusé placé en détention préventive, jusqu’à ce que le Tribunal fédéral l’y oblige en automne dernier. Pour chacun d’entre eux, être responsable d’avoir emprisonné un innocent pendant 5 ans, cela aurait fait tache. Des indemnisations de plusieurs millions auraient fait débat.
Quant à Erwin Sperisen, il ne fit rien pour désamorcer ce dilemme. Bien au contraire. Sa critique du système judiciaire genevois exprimée aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de la salle d’audience resta acerbe. Il ne fit ni concession ni auto critique. Dans sa prise de parole finale, il demanda même la démission de Bertossa. De son point de vue, cette attitude peut être compréhensible. Passer 5 ans dans une cellule de 9.4 mètres carrés en étant innocent – oui, la présomption d’innocence vaut jusqu’à preuve du contraire même pour un chef de police guatémaltèque – reste une expérience amère. Quant à savoir si cette posture était stratégique ou psychologiquement adéquate est une autre question. Les juges tiennent le couteau par le manche, ce sont eux qui ont le dernier mot.
Les juristes aiment se présenter comme détenteurs d’une science capable d’évaluer les arguments et de parvenir à un résultat cohérent, quels que soient l’origine ou la notoriété des sujets de droit. En règle générale, tout cela fonctionne à merveille. Mais les juges ne sont pas des robots. Comme tout être humain ils sont soumis à la pression sociale et suivent un instinct de survie quand il s’agit de sauver leur peau.
Les plaidoyers hautement émotionnels des deux parties auront souligné ces aspects avec une rare évidence. Faute de preuves solides et fiables, d’indices concrets, de part et d’autre la bataille se déroula avec force insinuations, suppositions, attaques personnelles ou astuces rhétoriques. Cette bataille psychologique n’avait de juridique que le nom.
Au premier abord, le cas semble limpide. Sept détenus furent assassinés en 2006 lors d’une razzia au sein d’une prison, qui était placée sous le commandement d’Erwin Sperisen. Mais il n’est simple qu’en partie. Car l’armée, le personnel de la prison, les services secrets et des troupes spéciales du ministère de l’intérieur étaient également de la partie. La justice genevoise prit beaucoup de temps et d’énergie pour tenter de comprendre si l’exécution des détenus eut lieu alors qu’ils s’étaient déjà rendus. Ce scénario prévaut, mais la question déterminante en l’espèce, qui fut traitée de façon rudimentaire et en proférant des lieux communs reste vraiment difficile à résoudre : quel rôle avait joué Sperisen, le responsable politique de la police, au sein de ce complot ?
L’enquête partielle, opaque et politiquement contaminée menée par le Guatemala livra quantité de rumeurs et d’affirmations contradictoires, mais peu de preuves tangibles. Sperisen ne pouvait ou ne voulait pas non plus présenter de solution. Toutefois dans un système juridique civilisé, ce n’est pas l’accusé qui est responsable de prouver son innocence. Au final, le principe «in dubio pro reo » prévaut.
Dès le départ, une odeur politique pesa sur la procédure. Plus on tentait de réprimer le sentiment de partialité, plus il se manifestait ouvertement. La composante politique ne put non plus être écartée même en faisant preuve d’« acrobatie juridique » : la procédure, dirigée en son cœur contre l’ancien gouvernement conservateur de droite d’Oscar Berger, fut attaquée et menée par les activistes de l’ONG Trial, interconnectée avec la gauche au Guatemala aussi bien qu’avec l’appareil judiciaire et politique genevois.
Les théories racistes de Yves Bertossa
Le procureur Bertossa l’affirme clairement et sans détours dans son plaidoyer final : Erwin Sperisen représente cette classe sociale blanche au Guatemala, qui semble, comme au temps du colonialisme, dominer et exploiter une population majoritairement indienne. Bertossa n’a encore jamais foulé le sol de ce pays, sa théorie raciste a été vérifiée dans la pratique. Mais la cité mondiale de Genève compte en effet beaucoup de services, de sociologues et de professeurs capables d’annoncer chaque jour ce que selon son idéologie se passe dans le tiers monde.
Pour le Tribunal fédéral, il n’y a rien de pire que la politique. Pendant deux ans, les juristes à Lausanne ont couvé le cas. Il en résulte un verdict de cent pages, qui souligne de graves manquements dans le cadre du verdict genevois contre Sperisen : mépris des droits de la défense, arbitraire dans l’exposé des motifs, violation de la présomption d’innocence. Mais le Tribunal fédéral laisse également d’incertitudes. La question cruciale resta ouverte : les exécutions furent-elles menées sur ordre, ou du moins avec l’accord du chef de la police ? Le Tribunal fédéral renvoya la responsabilité de trancher à Genève.
Justifier la condamnation initiale avec les miettes restantes de la procédure menée devant le Tribunal fédéral aurait été audacieux. Mais il aurait fallu encore plus de courage pour acquitter Sperisen et le dédommager. Cela aurait été une banqueroute juridique. Le tribunal choisit une troisième voie : Erwin Sperisen est à moitié coupable. Il n’a pas conçu le plan morbide, ni n’a contribué à son exécution, mais il a laissé le champ libre au commando de tueurs. La peine fut donc réduite à 15 ans.
Le journal de la SSR, en Suisse allemande, commenta le verdict en ces termes : « Genève a entendu la critique du manque de preuves et donc renoncé à une condamnation à vie ». On pourrait formuler cela de manière plus directe : si Sperisen devait ne pas être coupable, il passerait moins de temps derrière les barreaux.
Le verdict suit la tactique du procureur Yves Bertossa, qui se déroule tel un fil rouge au travers de toute la procédure. Lorsqu’une version devenait caduque, il en construisait de suite une nouvelle. C’est ainsi que l’actuel procès présentait trois assassinats supplémentaires, le soi-disant cas «El Infiernito», pour lequel Sperisen avait été disculpé en première instance. Bertossa demanda que l’enquêteur espagnol Fernando Toledo, qui figure comme témoin clef dans ce dossier, vienne exprès à Genève. Lorsque Toledo dut concéder en sa qualité de témoin qu’il avait menti – soit qu’il n’avait jamais été impliqué dans les assertions concernant «El Infiernito» - , Bertossa laissa tomber l’accusation concernant ce dossier parallèle sans autre commentaire. Au premier abord, cela peut paraître généreux. Mais il élimina d’un élégant coup d’échec une fausse déclaration en plus figurant au procès, qui révèle le caractère tendancieux de l’enquête.
Selon le premier verdict genevois, Erwin Sperisen aurait été personnellement impliqué lors des exécutions. Cette version se base essentiellement sur les accusations du meurtrier Philippe Biret, qui s’était livré comme témoin clé à Bertossa et avait été récompensé par une libération anticipée au Guatemala. Les affirmations de Biret contredisaient les faits de manière si grotesque que la chambre d’appel les élimina. Dans le cadre du 2e verdict, la posture de Sperisen fut jugée douteuse, parce qu’il se tenait passivement en arrière-plan. La Cour se contenta de la simple formule livrée par Bertossa : « Les chefs commandent, les subordonnés exécutent ».
Les bons amis n’ont pas de secrets
Voici donc la troisième variante. Elle renverse la hiérarchie. Ce n’est plus Sperisen, le chef, mais son subordonné Javier Figueroa qui a planifié et commandité l’exécution des prisonniers. Cette version s’appuie pour l’essentiel sur la déclaration de l’agent secret et témoin clé Luis Linares Pérez, qui avait contribué à la fusillade et fut récompensé pour ses diverses déclarations contradictoires, revues et corrigées par une exemption de peine et un permis de travail canadien.
Sperisen et Figueroa s‘étaient donné rendez-vous avant la descente à la prison dans une station essence, et s’étaient rencontrés après la fusillade sur le lieu des événements, alors que, entre autres, des unités de commando étaient également présentes. L‘objet des conversations n’est pas transmis. Le fait qu’Erwin Sperisen et Javier Figueroa étaient amis d‘enfance fut suffisant pour le Tribunal de première instance pour signifier qu’ils n’avaient pas de secret l’un pour l’autre.
Mais le problème demeure : en effet, Javier Figueroa fut blanchi de toute culpabilité et de toute peine par un procès en Autriche en 2013, dans le cadre d’un jury populaire. Depuis, aucun nouvel élément n’est venu s’ajouter à ce dossier qui aurait justifié l’ouverture d’une nouvelle procédure. Dans le cas d’espèce, le Tribunal fédéral a retenu que les juges genevois ne pouvaient sans autres passer outre cette libération. Ce faisant ils violeraient la règle de droit fondamentale «ne bis in idem» (pas de deuxième procès dans la même affaire) et la présomption d’innocence. Pour autant, le verdict autrichien ne constituait non plus de contrainte pour la Suisse.
Le Tribunal fédéral doit donc expliquer ce qui prévaut. D’ici là, Erwin Sperisen est remis en liberté. La justice genevoise a ainsi élégamment délégué la décision à Lausanne. Ce procès, qui traîne en longueur depuis six ans et qui a depuis précipité la moitié du clan Sperisen dans la misère, développe à vue d’œil des parallèles fantomatiques avec les lynchages perpétrés au Guatemala : l’horreur a eu lieu, c’est certain, mais personne n’est responsable.
6. République fromagère hors-jeu
15.08.2019 - Selon la justice genevoise, Alejandro Giammattei serait un meurtrier de masse. Mais le dimanche passé, le peuple du Guatemala a élu cet homme à la tête de l'Etat. C’est plus que embarrassant pour la Suisse.
Le résultat est hors de doute : avec environ 20 points (pour cents ?) d'avance sur sa rivale Sandra Torres, le docteur Alejandro Giammattei a été élu nouveau président du Guatemala dimanche dernier. La victoire nette peut surprendre pour plusieurs raisons. D'un côté, il semble douteux que le politicien conservateur de droite atteint de sclérose en plaques survivra à son mandat de quatre ans. De l’autre côté, Giammattei par la justice Genevoise a été reconnu coupable d’avoir ordonné l’exécution de sept gangsters emprisonnés en tant qu’ancien chef de l’autorité pénale à l’occasion d’une perquisition en 2006.
Au Guatemala, Alejandro Giammatei a été acquitté dans de sa culpabilité et de son châtiment en 2014. De la même manière ses complices présumés, le ministre de l’Intérieur, Carlos Vielman, et le commandant de la police, Javier Figueroa, ont été relevés et réhabilités en Espagne et en Autriche. Cependant, le pouvoir judiciaire genevois, qui devait juger un quatrième accusé dans cette affaire, avait un avis différent : elle a condamné Erwin Sperisen, alors chef de la police politique, pour les meurtres dans la prison. Mais parce qu’on ne pouvait pas lier directement les exécutions avec Sperisen - en plus que pour un complot il faut au moins deux acteurs - les juges de Genève ont simplement condamné les acquittés à l'étranger avec lui, en leur absence, sans qu'ils puissent se défendre.
Depuis près de sept ans, l'affaire contre Erwin Sperisen a été bagoté dans les cabinets judiciaires suisses. A Genève il a été condamné à trois fois, soit comme acteur principal, soit comme auteur intellectuel, soit comme complice passive, avec des justifications qui auraient difficilement pu être plus contradictoires. Depuis un an, le dossier se repose à nouveau a Mon Repos devant la cour fédérale. La base du procès, les dossiers de la commission d'enquête internationale Cicig, qui aurait dû éclaircir le massacre d'une prison au Guatemala sous l'égide de l'Uno, sont pleins de contradictions, de lacunes et de revirements. Un bouquet coloré de rumeurs contraste avec un manque flagrant de preuves.
Par tous les moyens, les juges genevois et le procureur Yves Bertossa luttent contre l'acquittement en souffrance. Le débâcle serait colossal. Au lieu de montrer au monde comment faire justice, Genève, supposée capitale humanitaire du monde, devrait payer à Erwin Sperisen une récompense millionnaire pour incarcérer un innocent pendent cinq ans de détention provisoire et de contrainte, en isolation presque totale. Même pour la Confédération Suisse, le processus de modèle supposé est devenu un cauchemar. Après tout, le Département des Affaires Extérieurs (DEFAE) a cofinancé la Cicig depuis des années.
Justice pervertie en menace pour l’état de droit
Au Guatemala, les enquêteurs internationaux de l'ONU depuis longtemps ont perdu toute crédibilité. Contaminé de machinations politiques, les détenions spectaculaires de la Cicig ont mené rarement à des jugements fiables et fondés. Au contraire, la Cicig est devenu une menace supplémentaire pour l’état de droit déjà faible et rudimentaire au Guatemala. L'arbitraire, la corruption et la violation des droits de l'homme sont sans aucun doute un otage omniprésent dans ce pays d'Amérique centrale. Mais les processus politiques de Cicig n'en sont pas exempts, au contraire, ils en font partie. Le gouvernement toujours en place de Jimmy Morales a donc relégué les enquêteurs internationaux du pays et a annulé son mandat.
Par la majorité des guatémaltèques, l'ancien chef de la police, Erwin Sperisen, est perçu comme la victime d'un système de justice politique manipulé depuis l'étranger. Avec consternation croissante, on suit les acrobaties de la justice kafkaïenne des tribunaux de Genève. Les commentaires des 34782 followers du compte Facebook de Sperisen parlent une langue assez claire: la République bananière de l’Amérique centrale semble avoir trouvé son pendant dans la République fromagère au pied des Alpes sur l'autre côté de l'Atlantique. Il y a déjà un an, le gouvernement guatémaltèque avait engagé l'épouse de Sperisen, Elisabeth, au poste de secrétaire d'ambassade à Berne. C'était un pointeur démonstratif à l'adresse de la Suisse officielle : Au Guatemala, Erwin Sperisen est réhabilité.
L'élection à la tête de l'État de Alejandro Giammmatei, en Suisse présumé meurtrier de masse, tourne la tragédie judiciaire définitivement en en farce. Les machinations de Cicig, cofinancées par la Suisse, ont été un sujet de discussion important pendant la campagne électorale - et apparemment pas au détriment du candidat Giammattei. Autant que, à l’époque, en 2006, Giammattei comme chef d'établissement pénitentiaire il était le seul qui avait un motif tangible pour éliminer les chefs de gangsters emprisonnés : ils l'avaient menacé de mort, lui et sa famille, à l'approche d'un raid pénitentiaire planifié.
Même l'adversaire de Giammattei dans la campagne électorale récente, la socialiste Sandra Torres, était déjà en guerre avec le Cicig. Selon un rapport, en 2007 elle aurait financé avec sa sœur Gloria la campagne électorale de son mari Alvaro Colom, avec des fonds du tristement célèbre cartel Zeta. Mais à peine élu président, Colom a mis, détournant de ses propres affaires louches, les enquêteurs de la Cicig sur le gouvernement prédécesseur. Le processus politique contre Giammattei et Sperisen en était le résultat. Le cercle se ferme.
7. Kafka à Genève
5.12.2019 - Au bout de sept ans, le Tribunal fédéral a mis fin au procès Sperisen avec un verdict de culpabilité qui n'apporte aucun éclaircissement. La tentative d'assurer l'ordre public au Guatemala depuis Genève a échoué. Une leçon sur les limites de la justice.
Les réactions à Genève au verdict de Lausanne ont été étrangement prudentes, les bulletins dans les médias étonnamment brefs. Pourtant la justice genevoise, très critiquée pendant les procès, a obtenu un succès longtemps attendu dans une affaire prestigieuse, en condamnant Erwin Sperisen, l'ancien chef politique de la police du Guatemala, à quinze ans de prison. Mais personne ne semblait vraiment satisfait. Trop d’irrégularités, trop de contradictions et d’erreurs ont été mises en lumière au cours de ces sept années de procès pour qu’on puisse encore avoir confiance en cette affaire.
Fati Mansour, doyenne des chroniqueurs judiciaires de Suisse romande très proche des procureurs genevois, s'est félicitée d’un "procès essentiel" dans Le Temps, qui à son avis a fait franchir une nouvelle étape aux poursuites pénales internationales. Mais le fait que cela exigeait une interprétation "plutôt acrobatique" de la loi n'avait pas échappé non plus à son attention. Mansour a rappelé l'oligarque russe Sergei Mikhailov, que la justice genevoise avait dû indemniser pour un montant de 800 000 francs suisses il y a vingt ans pour l'emprisonnement d'un innocent. Cette fois une telle disgrâce a été épargnée à Genève.
Mais Mansour se trompe doublement. Tout d'abord, l'affaire du double national suisso-guatémaltèque Erwin Sperisen est si singulière qu'elle ne se répètera que rarement. L’arrêt ne crée pas de précédent à cet égard. Deuxièmement c'est précisément ce processus qui a repoussé les frontières de la justice internationale. Après sept ans de va-et-vient, on ne sait toujours pas qui a tué sept prisonniers dans une prison au Guatemala en 2006 et dans quelles circonstances. On prétend qu'Erwin Sperisen doit y être pour quelque chose.
Justice corrompue et politisée
Au Guatemala, où Genève voulait assurer l'ordre public, le processus n'a rien changé. Le Président élu Alejandro Giammattei a envoyé un message de solidarité bien trempé à Erwin Sperisen et à sa famille.
Ses opposants politiques seront contents probablement, ses partisans outrés, mais au Guatemala, personne ne doute qu'il s'agissait d'un jugement politique. L'affaire Sperisen est l'un des centaines de processus politiques qui ont poussé le pays aux limites de l'ingouvernabilité. « Lawfare » est la dénomination du phénomène de l'autre côté de l'Atlantique, une combinaison de law (loi) et de warfare (guerre), la continuation de la politique avec les armes du droit. Le système judiciaire fatalement corrompu et politisé, héritage de trois décennies de terreur de la guérilla, est peut-être aujourd'hui la plus grande menace qui pèse sur la jeune démocratie guatémaltèque .
C’était le même gouvernement d'Oscar Berger (2004-2008), pour lequel officiait Sperisen, qui avait installé la commission d'enquête internationale Cicig dans le pays. La Cicig livra en 2010 la base du procès Sperisen. Entretemps, la Cicig, financée entre autres par la Suisse, a été chassée du Guatemala dans le mépris et la disgrâce. Certains de ses enquêteurs sont eux-mêmes soupçonnés de corruption.
Co-conspirateurs acquittés
Le résultat de neuf ans de procédure : Erwin Sperisen a été reconnu coupable en Suisse de n'avoir pas empêché le commandant de police Javier Figueroa de participer au meurtre de sept gangsters lors d'une descente de police dans une prison au Guatemala en 2006. Le jugement de Lausanne réitérait que Sperisen n'avait rien à voir avec « la planification, l'organisation, l'ordre, l'exécution, la gestion ou la supervision » du massacre. On lui reproche simplement de ne pas avoir arrêté Figueroa ou de ne pas l'avoir traduit en justice.
Le problème : Figueroa avait déjà été acquitté en Autriche en 2013 dans un procès basé exactement sur le même dossier que l'actuel procès. Les avocats de Sperisen se trouvaient donc dans la situation kafkaïenne de devoir défendre en premier lieu le présumé assassin Figueroa, un homme qui n'avait jamais été accusé à Genève et qui n'a pu ni se défendre ni s'exprimer, car il avait été acquitté depuis longtemps.
Et Figueroa n'était pas le seul facteur perturbant. Selon les accusations de 2010 de la Cicig et l’acte d’accusation de Genève, Erwin Sperisen faisait partie d'une conspiration au plus haut niveau du gouvernement. Mais alors que le procès contre lui était en cours à Genève, tous les conspirateurs présumés ont été progressivement acquittés : d'abord le directeur du système pénitentiaire de l'époque (et actuel président élu) Giammattei et son adjoint au Guatemala, puis le commandant de police Figueroa en Autriche, et finalement le ministre de l'intérieur Carlos Vielmann en Espagne. En conclusion, Sperisen est resté le seul conspirateur au niveau du leadership. Est-ce qu'il conspirait avec lui-même ?
Mais les Genevois ne se sont jamais laissé décourager par leur bon sens. Ils voulaient montrer au monde comment appliquer la loi dans une république bananière, coûte que coûte. Pour la soi-disant bonne cause, ils ont surmonté presque tout ce qui est sacré dans un État de droit par des acrobaties juridiques. Il s'agissait d'une performance audacieuse sans filet, dans laquelle les procureurs et les juges de Genève eux-mêmes ont été forcés de réussir : s'ils échouaient, il y avait la menace d'un crash total.
Le plus triste dans ce procès, c'est que Sperisen n'a jamais eu la chance d'être écouté sérieusement. Pour les procureurs et les juges de Genève, il était absolument clair dès le départ qu'un chef de police guatémaltèque - surtout un chef blanc ! - n'est jamais innocent. Pris au piège de leur romantisme « tiers-mondiste », ils croyaient connaître le Guatemala mieux que les Guatémaltèques. Et si on ne savait pas exactement ce que Sperisen avait fait, pensaient-ils, lui-même devait sûrement bien le savoir.
Le complexe Bertossa
Qui veut comprendre le jugement contre Sperisen, doit chercher dans l‘histoire. La référence de Mansour à la débâcle de Mikhaïlov donne la clé. L’ombre de Mikhaïlov n’a cessé de planer sur tout ce procès.
L'oligarque russe, cependant, n'était qu'un des nombreux méchants de pays étrangers lointains à qui le procureur général de Genève Bernard Bertossa (1990 à 2002) à l’époque voulait enseigner de bonnes mœurs. Ses coups spectaculaires - en particulier l'arrestation par Bertossa de l'ex-dictateur chilien Augusto Pinochet à Londres en 1998 - ont fait les gros titres dans les journaux du monde entier. Mais à Genève, le spectacle acrobatique se terminait régulièrement par un désastre judiciaire.
En 2006, Yves Bertossa (PS) a suivi les traces de Papa au Parquet de Genève. Deux ans plus tard, Bertossa junior décrochait son premier coup d’éclat international avec l'arrestation d'Hannibal Kadhafi. Ce fut un échec colossal. A la fin, la Suisse dut présenter des excuses officielles au tyran libyen.
Mais les Bertossa n'ont pas été impressionnés. Dans les coulisses, le père et le fils bricolaient la création d'un parquet mondial basé dans la ville cosmopolite de Genève, dans le but de faire tomber les potentats du monde entier sous le contrôle de l'ONU.
En 2012, l'ONG de gauche Trial a présenté à Yves Bertossa, récemment élu premier procureur, l'affaire Sperisen sur un plateau d'argent – un cas apparemment destiné à faire oublier toutes les défaites du passé. L'ONG avait fait venir le Français Philipp Biret du Guatemala avec l'aide des enquêteurs de la Cicig. Biret, définitivement condamné pour un double meurtre, purgeait une peine de 35 ans de prison à la prison d'El Pavon au Guatemala. Et il disait avoir vu de ses propres yeux comment le chef de police Erwin Sperisen avait tiré une balle dans la tête d'un prisonnier en 2006 lors de la descente de police.
Yves Bertossa a arrêté Sperisen fin août 2012, montant une spectaculaire opération de commando dans le centre de Genève. Sperisen est en détention préventive depuis. Mais Bertossa doit l'avoir reconnu dès le deuxième interrogatoire : Biret avait menti comme un arracheur de dents.
Selon la version de Biret, Sperisen avait tiré dans la tête d'un prisonnier avec un pistolet dans l'après-midi du raid. Mais aucun des morts n'avait de blessures à la tête ; toutes les balles provenaient de fusils ; et à l'heure en question, les sept prisonniers étaient tous à la morgue depuis longtemps.
Début 2013, le procureur Bertossa proposait à Sperisen un « plea bargaining », un arrangement judiciaire : s'il plaidait coupable sur un chef d’accusation secondaire et accablait ses supérieurs, il le laisserait s’en tirer avec une peine symbolique. Erwin Sperisen avait alors rejeté le marchandage. Bertossa était resté sur ses positions. Il s'était donc acheminé dans une voie à sens unique d'où il n'y avait pas de retour en arrière possible.
Plus la détention durait, plus pesait la disgrâce de la défaite. Bientôt un acquittement aurait été une catastrophe personnelle non seulement pour Bertossa, mais aussi pour tous les juges qui avaient couvert ses agissements acrobatiques.
Histoires extravagantes des témoins achetés
Bertossa espérait amener Sperisen à une confession avec un mélange d'isolement cellulaire et la perspective d'une peine fortement réduite. C’était la tactique sur laquelle reposait toute la procédure de la Cicig au Guatemala : les soi-disant accords de « pentiti » avec les témoins « protégés ». Ceux qui ont incriminé un supérieur sont restés impunis et ont été récompensés par un visa d'immigration canadien. La méthode est similaire à la torture. Et elle présente le même inconvénient : les déclarations soumises à chantage ne valent pas le papier sur lequel elles sont transcrites, à moins qu'il y ait des preuves solides. Mais il n'y a jamais eu de telles preuves dans l'affaire El Pavón.
Pour se sortir la tête du nœud coulant - un policier a peu de chances de survivre dans une prison guatémaltèque - les principaux témoins ont raconté les histoires les plus folles. Rarement l'une correspondait à l'autre.
Ils ont accablé toutes sortes de gens, sauf eux-mêmes, naturellement. Mis à part le meurtrier Biret - qui a été récompensé par sa libération de prison pour son conte de fées - personne ne voulait admettre avoir assisté directement à l'exécution des prisonniers. C'est sur cette base pourrie qu'Erwin Sperisen a été condamné, avec la bénédiction du Tribunal fédéral.
Erwin Sperisen a été condamné trois fois à Genève. Les sentences ne pouvaient pas être plus contradictoires. Dans un premier arrêt, il a été reconnu coupable d'avoir tiré personnellement sur un prisonnier. En appel, son absence sur les lieux du crime a été interprétée comme un subterfuge particulier. Comme chef de la police, selon une logique simpliste, il était responsable des actes de la police. Il n'a cependant pas échappé à la cour que c'est le chef du système pénitencier, Giammattei, qui a eu le commandement du raid, dans lequel l'armée, les services secrets, le personnel pénitentiaire et les troupes paramilitaires du ministère de l'intérieur étaient impliqués aux côtés de la police. Les Genevois condamnèrent donc sans cérémonie les quatre conspirateurs au niveau du commandement présumé alors qu’ils avaient été acquittés à l'étranger.
Explications ? Rien de rien !
C'en était trop pour la Cour fédérale. À l'automne 2017, sous la responsabilité principale de la juge Laura Jacquemoud-Rossari, elle a renvoyé l'affaire à Genève pour un nouveau procès avec de nombreuses critiques. Suivant les prescriptions de Lausanne, la Cour d'appel de Genève, sous la direction d'Alessandra Cambi Favre-Bulle, a produit une troisième version des faits en mai 2018.
Soudain, Sperisen ne jouait plus qu'un rôle de soutien passif. Le massacre avait donc été perpétré par des unités paramilitaires. Toutefois, le commandant de police Javier Figueroa, qui a été acquitté de cette accusation en Autriche, aurait été impliqué. Sperisen n'était plus accusé que d’avoir couvert Figueroa. Après tout, c'était un ami de jeunesse.
Mais qui est censé avoir exécuté les sept prisonniers et dans quelles circonstances ? Le Tribunal fédéral laisse également cela en suspens. Les responsables principaux, les chefs des troupes paramilitaires connus nommément - Victor Rivera et les frères Benitez - n'ont jamais été interrogés, ils ont eux-mêmes été assassinés depuis longtemps. Les mobiles de Sperisen sont également laissés en suspens par la Cour fédérale. On suppose qu'ils n'auraient pas pu être altruistes, sans aucune explication. Rien ne justifie non plus la peine de quinze ans de prison. Pourquoi pas dix ans ou vingt ans ? Il n'y a pas d'explication, rien de rien.
Les indices recueillis par le ministère public guatémaltèque immédiatement après la fusillade - d'une qualité déplorable, mais indices néanmoins - indiquent que les prisonniers ont été tués délibérément. De nombreux mobiles sont concevables. Au Guatemala, non seulement la police, mais aussi les gardiens de prison, l'appareil judiciaire et l'armée - le rôle de ces deux derniers n’ont jamais fait l'objet d'enquêtes - sont profondément impliqués dans le crime organisé.
Les prisonniers tués se trouvaient au sommet de la hiérarchie de la prison. Avant le raid annoncé, les chefs des gangsters avaient menacé d'exterminer toute la famille du directeur Alejandro Giammattei. Et si l’on peut compter sur quelque chose au Guatemala, ce sont les menaces de la mafia. Elles sont mises en œuvre. Au vu de l'anarchie qui sévit au Guatemala, il serait concevable que Giammattei ait fait tuer les gangsters pour se sauver et sauver sa famille.
Mais même si cela avait été ainsi – et ce n'est rien d'autre qu'une pure spéculation - la question demeure toujours : avait-il besoin du soutien d'Erwin Sperisen ?
C'était peut-être une erreur stratégique des défenseurs de Sperisen que de remettre en cause les meurtres eux-mêmes. Dans un processus normal, où tout doit être remis en question, cela aurait été leur devoir.
Mais dans cette affaire politiquement chargée, ils offraient ainsi aux tribunaux l'occasion d'éluder la question difficile et centrale : qu'est-ce que Sperisen a à voir avec ces meurtres ? Au niveau politique, on pourrait lui attribuer peut-être une responsabilité. Mais une culpabilité au sens pénal présuppose l'intention de commettre un crime concret.
Une collègue de Bertossa comme juge référente
Depuis un bureau bien chauffé à Genève ou Lausanne, il est facile de spéculer sur ce qu'un politicien devrait ou ne devrait pas faire dans la réalité brutale du Guatemala. Cependant, les juristes devaient être conscients que leurs acrobaties académiques étaient basées sur une enquête politiquement contaminée dont le contenu ne pouvait pas être vérifié. Quand une version du crime s'effondrait, ils en bricolaient simplement une nouvelle à partir des décombres. Ce qui ne rentrait pas dans le cadre, ils l'ont banni pas à pas des dossiers, cela n'existait plus.
Les cinq juges fédéraux de la Cour de droit pénal - deux Suisses allemands, deux Romands et une Tessinoise - sous la présidence de Christian Denys, vaudois, sont responsables de cet arrêt. En tant que juge référente, Laura Jacquemoud-Rossari a planché sur le dossier. Elle a rédigé le projet de jugement, qui a été accepté par ses quatre collègues. Jacquemoud-Rossari avait fait carrière à Genève en tant que procureur et juge ; elle publie toujours la revue Semaine Judiciaire avec son ancien collègue Bernard Bertossa.
De tels liens peuvent être habituels dans la branche, mais dans ce procès brûlant, une juge issue du milieu étroit et fermé de Genève n'inspire pas vraiment confiance.
Si l'un des cinq juges fédéraux n'est pas d'accord avec le projet de jugement, l’affaire doit être discutée publiquement. Il n'y a pas eu d'audience dans l'affaire Sperisen. Tous les juges ont apposé leur nom sous le verdict de leur collègue genevoise. Outre le président et la juge référente elle-même, il y avait Niklaus Oberholzer, Yves Rüedi et Monique Jametti.
Aucun de ces juges n’a-t-il vraiment craint d'envoyer une personne innocente derrière les barreaux et de partager ainsi la responsabilité d'un crime judiciaire ? Ou peut-être que personne n’a eu le courage de s'y opposer et de dire non ? Ce serait exactement l’accusation qui a finalement été retenue contre Erwin Sperisen.
8. Révision du procès Sperisen
16.1.2020 - A peine la Cour fédérale a-t-elle statué qu'une enquête menée au Guatemala remet tout en question. Les avocats de l'ancien chef de la police Erwin Sperisen exigent une reprise du dossier.
En décembre dernier, le Tribunal fédéral suisse a entériné une décision de Genève qui laisse perplexe : Erwin Sperisen, l'ancien chef politique de la police guatémaltèque, aurait couvert le commandant Javier Figueroa, impliqué dans un massacre dans une prison. Mais Figueroa - comme tous les autres co-conspirateurs présumés à ce niveau hiérarchique - a été acquitté dans exactement la même affaire à l'étranger avec force de loi. Comment alors peut-on être le complice d’un innocent ?
Le jugement kafkaïen ne peut s'expliquer que par une dynamique politique fatale à Genève. Comme le procureur Yves Bertossa a laissé Sperisen croupir en détention pendant plus de cinq ans avec la bénédiction des tribunaux, un acquittement aurait été un désastre pour l'ensemble du système judiciaire genevois. En étroite collaboration avec l'organisation non gouvernementale de gauche Trial, fondée avec son père, Bertossa voulait donner aux Guatémaltèques une leçon de justice. En cas d'acquittement de Sperisen, père de trois enfants mineurs, considéré comme une victime de la justice dans son pays d'origine depuis longtemps, aurait dû recevoir des millions en dommages et intérêts pour préjudice moral.
Comme Weltwoche l'a révélé le 5 décembre 2019 sur la base de l'indiscrétion d'un initié, la juge fédérale Laura Jacquemoud-Rossari dans cette affaire politiquement contaminée a joué le rôle de rapporteur. En d'autres termes : elle seule a creusé ce dossier complexe, et elle a rédigé le verdict, qui a été simplement approuvé par ses collègues juges. Mais Jacquemoud-Rossari ne vient pas seulement de Genève, où elle a construit sa carrière à la Cour de Justice aux côtés des deux juges chargées de l'affaire Sperisen, Isabelle Cuendet et Alessandra Cambi Favre-Bulle. En tant que coéditrice de longue date de la revue Semaine Judiciaire, elle est également associée au clan Bertossa. On peut difficilement imaginer un juge fédéral plus partial dans cette affaire.
Les avocats de Sperisen ont immédiatement demandé des éclaircissements au président de la Cour suprême fédérale, Ulrich Meyer. Malheureusement, Meyer a répondu par lettre datée du 23 décembre 2019 qu’il ne pouvait plus se prononcer sur une affaire classée, « mais que naturellement, la voie du recours vous est ouverte ». Et c'est précisément cette demande que les avocats de Sperisen, Giorgio Campá et Florian Baier, ont présentée à la Cour fédérale cette semaine. Ils exigent que les conflits d'intérêt privés des acteurs de l'affaire Sperisen fassent l'objet d'une enquête et soient divulgués.
Témoins achetés sous chantage
On peut se demander si les imbrications de Jacquemoud-Rossari suffirait pour un nouveau procès. Mais la semaine dernière, le parlement guatémaltèque a publié un rapport d'enquête explosif qui fournitüb de matière pour une révision en opulence. L'objet de l’enquête parlementaire était l'agence d'investigation internationale Cicig, qui dirigeait l’investigacion sur l'affaire Sperisen. Le budget de la Cicig, qui s'élève à 167 millions de dollars, a également été cofinancé par la Suisse. En août dernier, la Cicig a été dissoute après une série de scandales.
La commission d'enquête parlementaire apporte un témoignage accablant sur la Cicig. Comme le montre le rapport, l'autorité chargée de l'enquête criminel au Guatemala est devenue une sorte d'État dans l'État, sans aucun contrôle et sous la protection de l'immunité diplomatique. Les enquêteurs, dont la plupart venaient du continent latino-américain, ont fait chanter à loisir les juges et les procureurs locaux. Ceux qui ne suivaient pas les consignes devaient s'attendre à être emmenés menottes aux poignets devant des caméras, et à disparaître pendant des années dans une prison sans avoir été dûment inculpés.
L'arme principale de la Cicig était ce qu'on appelle la « colaboración eficaz », une sorte d'indulgence fabriquée. Celui qui était dans la ligne de mire des enquêteurs avait le choix : soit il noircissait le nom d'un supérieur et était récompensé par un visa de travail canadien - soit il était lui-même présenté publiquement comme un criminel et finissait en prison pendant quelques années. Comme ces accords forcés entraînent de fausses accusations, ils sont illégaux en vertu du droit suisse - et ils l'étaient également au Guatemala, du moins à l'époque où Erwin Sperisen et ses prétendus complices ont été inculpés.
En fait, toute l'affaire Sperisen repose presque exclusivement sur les vagues déclarations de ces témoins de complaisance. Il y a deux ans et demi, Daniel Jositsch, professeur de droit et membre du Conseil des États (SP), a conclu dans un avis d'expert que l'exploitation des déclarations de témoins de complaisance dans l'affaire Sperisen n'était pas a priori exclue (voir Weltwoche N° 22/17, « Révolte des professeurs de droit »). Dans un tel cas, cependant, le contenu de l'accord et les circonstances dans lesquelles il a été conclu devraient être communiqués et documentés. Le seul fait avéré est que les deux témoins décisifs dans le procès Sperisen ont été récompensés par une exemption de poursuites et des visas canadiens. Selon le rapport d'enquête du Guatemala, il ne pouvait pas s'agir d'accords honnêtes.